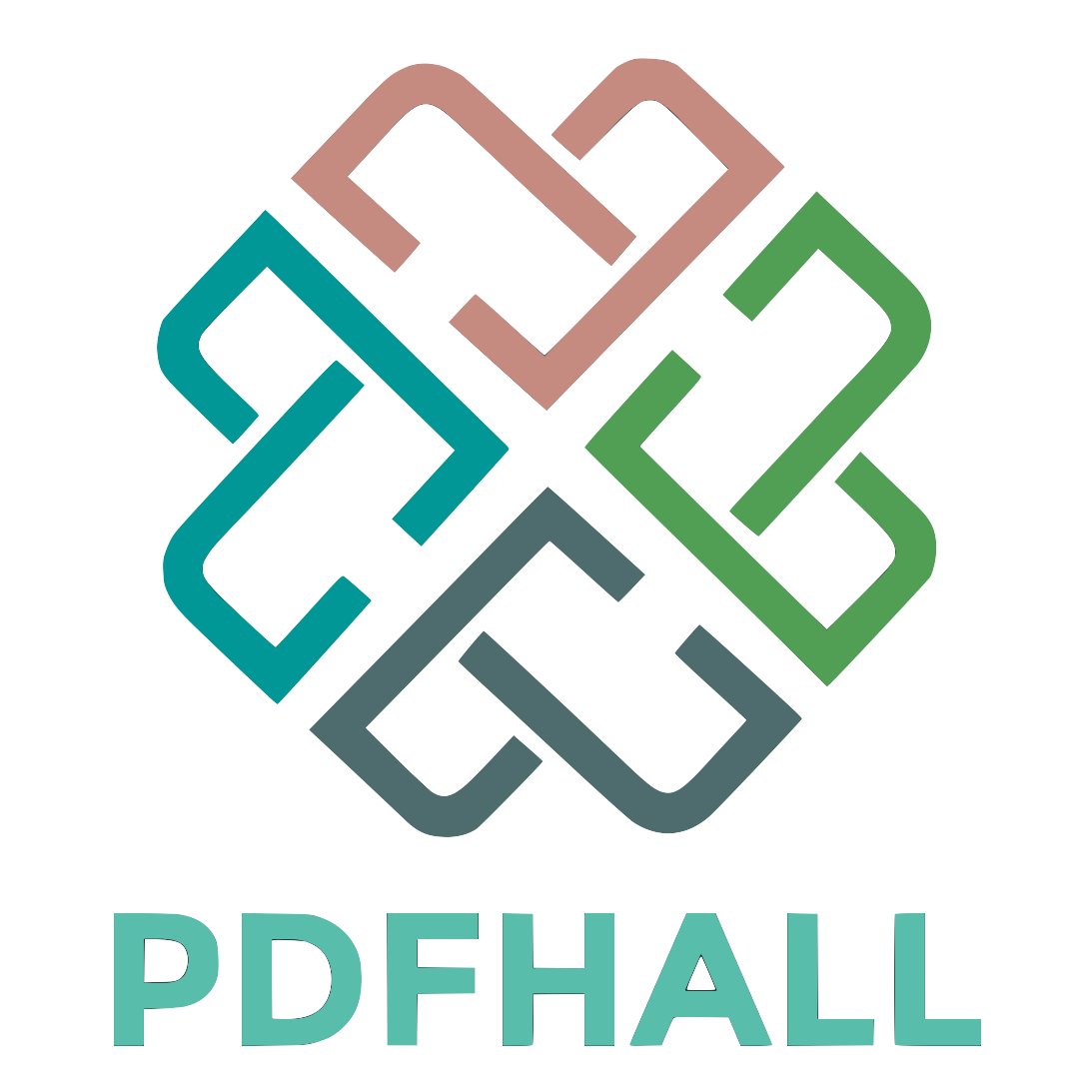REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÃTÃ DE CARLOTTA FILMS
à l'image de Jonathan Shields, le héros des Ensorcelés(Vincente Minnelli,. 1952), Selznick faisait partie d'une dynastie cinématographique. Il était le fils de.
LA CONQUÊTE DE L’INDÉPENDANCE REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
3
CHEF D’ORCHESTRE ET MAÎTRE DE MARIONNETTES (Fabien Delmas) REBECCA
un télex de selznick à hitchcock (Nicolas Saada) selznick, le producteur donne la note dans le hall des rois mogols (Alfred Hitchcock) sans tambour ni trompette (Claude Chabrol) l’absente (Nathalie Heinich) la projection permanente (Jean Douchet)
Crédits photographiques Couverture et photos des pages 43-48, 49 (haut), 50, 52, 53, 91-95, 98-100, 101 (bas), 102-108, 157170, 172, 173, 203, 205, 206, 207, 208 (haut), 239, 240 (haut), 242, 243, 244 (bas), 246-250, 251 (haut), 252 et 253 (haut) : INDEPENDENT VISIONS/MPTV. Tous droits réservés. Photos et illustrations des pages 49 (bas), 96, 97, 109 (bas), 110, 111, 171, 201, 202, 204, 209, 240 (bas), 241, 245, 254 et 255. Reproduites avec l’aimable autorisation de The Alfred Hitchcock Collection de The Academy Film Archive. Photos des pages 51, 101 (haut), 109 (haut), 200 (haut), 208 (bas) et 244 (haut). Reproduites avec l’aimable autorisation de Laurent Bouzereau. Page 63 (haut) : © UNITED ARTISTS. Tous droits réservés. Pages 63 (bas), 66 et 67 : © 1940 DAVID O. SELZNICK © ABC, Inc. Tous droits réservés. Pages 64 et 65 : © SELZNICK INTERNATIONAL PICTURES. Tous droits réservés. Pages 143-149 : © ABC, Inc. Tous droits réservés. Pages 195-198, 199 (haut) et 200 (bas) : © 1946 RKO. © ABC, Inc. Tous droits réservés. Page 199 (bas) : © RKO RADIO PICTURES - RADIO-KEITH-ORPHEUM. Tous droits réservés. Pages 251 (bas), 253 (bas), 256 et 257 : © ABC, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de l’ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur et de ses ayants droit. Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce livre, malgré les soins et les contrôles, ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. Nous adressons nos sincères excuses aux détenteurs de copyrights qui, malgré nos efforts, auraient été involontairement oubliés. Nous rectifierons ces éventuelles erreurs lors de la prochaine édition de cet ouvrage, dans la mesure elles nous auront été signalées.
page 9 page 25 page 26 page 30 page 36 page 54 page 58 page 68
LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES
page 81
LES ENCHAÎNÉS
page 151
LE PROCÈS PARADINE
page 211
la touche hitchcock (Alfred Hitchcock) page 82 le thriller de cinéma (Alfred Hitchcock) page 86 la part du rêve (Nathalie Bondil) page 112 hitchcock, artiste malgré lui (Nathalie Bondil) page 130
notorious [alfred hitchcock] (Pascal Bonitzer) page 152 alicia au pays des dragons (Frank Lafond) page 174
seuls ensemble… (Benjamin Thomas) page 212
HITCHCOCK, BOGDANOVICH, CHABROL, LEXIQUE page 259 hitchcock/bogdanovich page 260 hitchcock devant le mal (Claude Chabrol) page 270 lexique mythologique pour l’œuvre de hitchcock (Philippe Demonsablon) page 278 Cahiers de photographies : voir pages 43, 63, 91, 143, 157, 195 et 239 REPRODUCTION INTERDITE
6
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
7
CHEF D’ORCHESTRE ET MAÎTRE DE MARIONNETTES SUR LA RELATION ENTRE ALFRED HITCHCOCK ET DAVID O. SELZNICK Fabien Delmas
8
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
9
La collaboration entre Alfred Hitchcock et David O. Selznick est emblématique d’une période charnière de l’histoire du cinéma américain. Elle correspond à l’apogée et au début du déclin d’un système qui fit s’épanouir le classicisme hollywoodien. 1938-1948, soit dix années qui coïncident avec l’affranchissement progressif du pouvoir de décision des producteurs. SelznickHitchcock, c’est aussi le récit d’une association légendaire entre l’un des producteurs symbole de l’exigence d’un système hégémonique et le cinéaste des cinéastes. La politique des auteurs, la légende, qu’il a parfois complaisamment entretenue, voudraient qu’Hitchcock ait eu l’ascendant artistique sur David O. Selznick. On néglige l’importance du producteur dans l’essor de la carrière américaine d’Alfred Hitchcock et dans les changements que connut le style du cinéaste anglais lorsqu’il arriva aux États-Unis. Cette collaboration fut ponctuée par quatre films, Rebecca (1940), La Maison du docteur Edwardes (Spellbound, 1945), Les Enchaînés (Notorious, 1946) et Le Procès Paradine (The Paradine Case, 1947). À ces œuvres s’ajoutent des dizaines et des dizaines de mémos envoyés compulsivement par Selznick et qui hérissèrent tant Alfred Hitchcock. La décennie qu’Hitchcock passa dans le giron de Selznick fut plus qu’une période de transition. La collaboration, parfois frustrante, parfois étouffante, fut pourtant fructueuse et productive. En mettant à la disposition du metteur en scène son savoir-faire et celui des techniciens hollywoodiens, Selznick permit à Hitchcock de donner corps à ses visions. À la fin des années 1930, David O. Selznick était l’archétype du producteur hollywoodien. Avec Irving Thalberg, le jeune producteur vedette de la MGM, il appartenait à la deuxième génération de dirigeants hollywoodiens. Ces producteurs ne faisaient pas partie des fondateurs ou des pionniers, mais étaient parvenus à une première synthèse de pratiques et de méthodes mûries. Ils étaient initiés aux formules artistiques, économiques et pragmatiques de l’industrie. Détail qui n’en est pas un : contrairement aux pères fondateurs du cinéma américain, Selznick naquit après l’apparition du cinéma et après 1900, au moment où Broadway et Hollywood virent se concentrer et se sédentariser des activités culturelles, spectaculaires et économiques qui déterminèrent, en la symbolisant, la culture américaine du XXe siècle. À l’image de Jonathan Shields, le héros des Ensorcelés (Vincente Minnelli, 1952), Selznick faisait partie d’une dynastie cinématographique. Il était le fils de Lewis J. Selznick, fondateur de Lewis J. Selznick Production, Inc. qui prospéra avant de connaître la ruine au début des années 1930. À l’image de Jonathan Shields, Selznick bâtit son propre studio en appliquant à la fabrication de ses films des méthodes acquises à l’ombre des hangars de la Paramount (1928-1931), de la RKO (1931-1933) et de la MGM (1926-1928 puis 1933-1935). Démiurge se rêvant omnipotent, David O. Selznick était expansif, envahissant, imposant
10
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
11
et consommait des quantités invraisemblables de benzédrine pour nourrir son hyperactivité. Il était surtout un créateur obsédé par le détail, la recherche de l’excellence et l’affirmation de l’exigence d’un savoir-faire qu’il érigea en credo de sa société de Selznick International Pictures, « Dans la tradition de la qualité ». Selznick se démarqua par son instinct et son goût sûrs. Les cinéphiles doivent à son flair George Cukor, Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Vivien Leigh et Jennifer Jones. En 1935, en fondant son propre studio, Selznick donna vie à un projet aussi risqué qu’ambitieux : produire en tant qu’indépendant des films d’une qualité supérieure qui concurrenceraient ceux des principaux studios. Le nom de Selznick renvoie systématiquement aux célèbres mémos qu’il dictait fiévreusement, névrotiquement, à ses secrétaires, dans la nuit californienne, et dont il inondait l’ensemble de ses collaborateurs. S’est-on interrogé sur la volonté de conservation qui permit à ses notes de nous parvenir ? En 1965, après la mort de leur père, les fils de David O. Selznick firent don de ses archives à l’université du Texas1. Ce legs, comprenant les fameux mémos, représentait une masse de vingt-six tonnes de documents. En produisant des films tels que King Kong (RKO, 1933) ou Autant en emporte le vent (Gone with the Wind, 1939), Selznick aspira à contribuer durablement à l’histoire du cinéma dont il avait une conscience accrue. On sait, par ailleurs, que parallèlement à ses activités de producteur, il poursuivit le projet d’éditer une anthologie de scénarios et une histoire photographique du cinéma2. À ce titre, le retour sur les relations personnelles et professionnelles qu’il entretint avec Alfred Hitchcock revêt une dimension historique significative. L’entente entre les deux hommes fut fructueuse, mais continuellement ponctuée par des conflits et une méfiance réciproque qui ne fit que s’accroître. Durant dix années, au fil des projets, au fur et à mesure que l’influence de Selznick se réduisit et que son rayonnement s’accrut, Hitchcock n’eut de cesse d’aspirer à l’indépendance et au statut de producteur. Pourtant, sur le plan artistique, le récit de la collaboration entre Hitchcock et Selznick est d’abord celui d’une entente quasi-symbiotique, formidablement complémentaire. La maîtrise de l’art du récit hérité de la littérature du XIXe siècle et la profondeur apportée à la caractérisation des personnages étaient les fondements de la conception de Selznick. Ce soin accordé aux aspects narratifs du film permettait l’établissement d’une trame solide à partir de laquelle Hitchcock put expérimenter et développer un formalisme spécifique au cinéma. L’association entre Hitchcock et Selznick se développa durant une période décisive qui vit la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’entérinement du décret Paramount. Cette association fascine 1. Sylvie Pliskin, « Université du Texas à Austin : les archives de David O. Selznick », Cinémathèque n° 1 (Paris), mai 1992, p. 114. 2. Ibid. REPRODUCTION INTERDITE
12
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
parce qu’elle réunit un producteur hollywoodien qui pourrait prétendre au statut d’auteur et un cinéaste que les tenants de la politique des auteurs érigèrent en totem. Peut-être plus qu’aucun autre producteur, Selznick avait une vision totalisante de la création filmique. Il intervenait à chaque étape de l’élaboration du film. De l’écriture, au casting. Incontestablement, son royaume était la salle de montage où le producteur pouvait manier, remanier et manipuler à l’envi la matière filmique, jouant avec les multiples combinaisons narratives et rythmiques, jonglant avec la multiplicité des angles de prises de vues déterminés lors du tournage. L’une des analogies qu’il cultive le plus dans les documents qui nous sont parvenus, consiste à assimiler sa vision des fonctions de producteur à l’art d’un chef d’orchestre. L’image sied bien à Selznick qui se voyait comme un créateur dont la mission était de mettre le pragmatisme au service de l’excellence. Cette conception induit la pluridisciplinarité, la coordination entre des techniciens et des chefs de poste aguerris et, dans une mesure qui n’est pas négligeable, l’obéissance. Paradoxalement, Selznick s’est souvent attaché les services de cinéastes au style très affirmé. Ce fut le cas de King Vidor, George Cukor, William Dieterle, et, évidemment, d’Alfred Hitchcock3. Les négociations sur une collaboration entre les deux hommes débutèrent en 1936. À la fin des années 1930, avec Chantage (1930), L’Homme qui en savait trop (1934) et Une femme disparaît (1938), Alfred Hitchcock était déjà considéré comme le cinéaste le plus important d’Angleterre4. David O. Selznick entra en concurrence avec la MGM et la RKO pour s’attacher les services du metteur en scène. Malgré la flatteuse publicité dont Hitchcock jouissait aux États-Unis, l’obtention d’un engagement dans un grand studio n’allait pas de soi. Nul ne savait si le cinéaste anglais serait capable de satisfaire aux exigences commerciales. Surtout, nul ne savait si Hitchcock serait capable de soutenir l’important rythme imposé par le système de production5. Entre 1929 et 1937, il n’avait pas réalisé plus d’un film par an. Ses œuvres, à l’exception des films policiers, n’avaient connu qu’un succès modéré. Parmi les studios intéressés par Hitchcock, Selznick était sans doute le seul à pouvoir proposer au réalisateur un cadre artistique favorable à son épanouissement, tout en satisfaisant les exigences matérielles d’Hitchcock qui, pour le moins, confinaient à la gourmandise. Il convient aussi de souligner l’importance du rôle joué par le frère de David O. Selznick, Myron,
3. Rudy Behlmer, David O. Selznick. Cinéma [Memo from David O. Selznick, 1972], traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Villelaur, Paris, Ramsay, 1984, p. 13. 4. Ronald Haver, David O. Selznick’s Hollywood, Londres, Secker and Warburg, 1980, p. 313. 5. Leonard J. Leff, Hitchcock & Selznick : la riche et étrange collaboration entre Alfred Hitchcock et David O. Selznick à Hollywood, [1987], traduit de l’anglais (États-Unis) par Georges Goldfayn, Paris, Ramsay, 1990, p. 26.
13
APRÈS AVOIR IMPOSÉ UNE SUÉDOISE DANS INTERMEZZO [INGRID BERGMAN], UNE ANGLAISE DANS AUTANT EN EMPORTE LE VENT [VIVIEN LEIGH], SELZNICK DÉCIDE D’EMPLOYER DANS REBECCA CELLE QUE TOUT LE MONDE APPELLE « LA FEMME DE BOIS » : JOAN FONTAINE. LE GRAND HITCH EN FERA BIEN QUELQUE CHOSE, À CONDITION QU’IL NE PRÉNOMME PAS L’HÉROÏNE DAPHNÉ EN HOMMAGE À DU MAURIER, AUTEUR DU BEST-SELLER.
SELZNICK, LE PRODUCTEUR DONNE LA NOTE
(…) Bien que Rebecca n’ait pas déclenché dans le public un enthousiasme aussi considérable qu’Autant en emporte le vent, ce fut pour moi une expérience presque aussi passionnante. Durant un an, j’avais discuté avec Joan Fontaine et je lui avais fait faire des essais. Au cours de ces tractations, j’ai proposé à Sam Goldwyn et au producteur Hal Roach de signer avec elle un contrat à trois, mais ils visionnèrent ses autres films et ne voulurent pas d’elle. RKO lui donna deux jolies chances puis la laissa partir. À Hollywood, certaines personnes pensaient qu’elle avait si peu de talent qu’elles l’appelaient « la femme de bois ». Personne à notre place ne lui aurait proposé un centime pour jouer le rôle, et on ne comprenait pas pourquoi je m’obstinais à refuser les grandes stars qui brûlaient du désir de l’interpréter. (…) À un certain moment, je finis par fléchir, me disant que je ne pouvais pas être la seule personne lucide au monde, et j’acceptai qu’on renonce à l’option que j’avais prise sur Melle Fontaine. Puis, une semaine avant le début du tournage, je me rebiffai de nouveau. J’arpentai ma chambre toute une nuit en ruminant l’idée que, si on choisissait mal la vedette de Rebecca, le film serait mauvais. Et, puisque j’avais eu le culot d’engager une Anglaise pour interpréter Scarlett O’Hara, pourquoi n’aurais-je pas le courage de mes propres opinions à propos de Fontaine ? Je me dis qu’elle allait bénéficier de la direction du grand réalisateur que j’avais engagé pour le film, Alfred Hitchcock. Et j’arrivai au studio, plein d’allant, tôt le lendemain matin, décidé à l’engager.
30
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
31
À M. Alfred Hitchcock 12 juin 1939 Cher Hitch, Il me revient la tâche fâcheuse et désagréable de vous dire que j’ai été choqué et déçu au-delà de toute expression par l’adaptation de Rebecca1. Je la considère comme une version déformée et vulgarisée d’une œuvre qui s’est révélée un succès, et dans laquelle, pour des raisons qui m’échappent, des séquences parfaitement surannées ont été substituées aux scènes de Daphné du Maurier au charme captivant. C’est particulièrement vrai pour la séquence de la Riviera. (…) À mon avis, la différence des moyens d’expression ne justifie qu’une seule chose : que chaque scène soit racontée différemment. Et les seules coupures que l’on peut pratiquer dans un ouvrage à succès ne doivent leur justification qu’à des problèmes de longueur, de censure, ou d’autres considérations pratiques. Les lecteurs d’un livre qu’ils aiment beaucoup pardonneront les coupures si elles répondent à des raisons évidentes ; mais, à très juste titre, ils ne trouveront aucune excuse à des substitutions. Je ne suis pas non plus partisan de la théorie selon laquelle, pour faire un film, il faut changer les histoires parce qu’elles appartiennent à un genre dit « narratif ». J’ai adapté avec succès, et fidèlement, trop de classiques, pour ne pas savoir, sans l’ombre d’un doute, qu’un film, qu’il soit narratif ou dramatique, rencontrera autant de succès que l’original si l’on se soucie de conserver les éléments essentiels de l’original – y compris les prétendus « défauts » de construction dramatique. Personne, pas même l’auteur de l’œuvre originale, ne peut dire avec certitude pourquoi un livre a eu la chance de plaire au public. Si c’était facile, l’auteur n’aurait qu’à reprendre les mêmes éléments et retrouver le même succès, ce dont, nous le savons, très peu d’auteurs à succès ont été capables. (…) C’est pourquoi je n’ai cessé de vous prier d’être fidèle. J’ai moi aussi ma vanité d’auteur et il ne me déplaît pas de lâcher la bride à mes instincts créateurs sur un scénario original, comme ce fut le cas dans Une étoile est née, ou en adaptant une œuvre littéraire, comme dans Le Lien sacré. Mais mon ego n’a pas tant d’importance que je ne puisse le réprimer en adaptant un ouvrage à succès. Je ne crois pas pouvoir créer, en deux mois ou en deux ans, quoi que ce soit qui rivalise avec les personnages et les situations de Rebecca, tels que du Maurier les a créés. Et franchement, je ne crois pas que vous en soyez capable non plus. Je veux que cette compagnie produise Rebecca, et non un scénario original tiré de Rebecca. 1. Écrite par Philip MacDonald et Joan Harrison sous la direction d’Hitchcock.
32
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
J’espère que vous n’avez pas l’intention de donner à la fille le nom de Daphné ou tout autre nom. Immédiatement après le fait que le personnage qui donne son titre au livre n’apparaît jamais, ce qui a le plus frappé les lecteurs est que le personnage principal n’a pas de nom. Welles en a astucieusement tiré profit, et les dix ou quinze millions d’auditeurs qui ont été fascinés par l’histoire savent aussi que le personnage principal n’est jamais nommé. Nous serions tout à fait stupides de lui donner un nom dans notre film. Il n’est pas question ici de l’art de raconter une histoire, mais simplement de l’art du spectacle. (…) Il serait trop long d’entrer dans les détails de la rancœur qu’ont fait naître en moi les autres changements. De toute évidence, il y a des répétitions dans le livre, et il faudra réunir plusieurs scènes pour en faire une seule. Mais ce n’est pas une excuse pour transformer la sœur de Max en une autre Mme Van Hopper ; pour rejeter les portraits merveilleusement dessinés et très intéressants de sa sœur et de son beau-frère ; pour faire une comédie burlesque de ses exploits sur un terrain de golf, au lieu d’exprimer l’atmosphère de la promenade dans la propriété, avec une petite discussion très humaine à propos du chien qui court sur les rochers, et l’étrange comportement de Max qui en découle. La façon dont les lecteurs du livre sont peu à peu intrigués par la conduite mystérieuse de Mme Danvers, et les curieuses réactions de Max à certains détails, tout cela a été peu ou prou déformé, et il faudrait des jours et des jours pour les passer au peigne fin et voir, point par point, ce qu’on a perdu, exactement comme dans la séquence sur la Riviera. Je dois dire carrément que je trouve l’adaptation très mauvaise, et qu’il est plus facile d’en faire une autre que de raccommoder celle-ci. (…) Je ne comprends pas (…) pourquoi vous avez tenu à mettre la grandmère dans la tour de Manderley. Sans chercher d’autres raisons, le fait qu’elle ait sa propre maison permet de briser la monotonie née de sa présence continuelle dans les décors de Manderley. Cependant, il est possible que ce ne soit pas très important car il y a beaucoup de décors à l’intérieur de Manderley, son domaine, etc. et qu’il soit, au contraire, intéressant de ne pas en sortir. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que la grand-mère serve à grand-chose, et peut-être devrait-on la supprimer2. Il manque aussi d’autres petites choses, comme les nombreuses comparaisons entre Rebecca et la jeune fille qui amène celle-ci à avoir conscience de sa propre gaucherie – par exemple, quand elle compare son écriture à celle de Rebecca. (…) Je ne sais pas pourquoi vous avez transformé l’abri à bateaux en un petit cottage de pierre. C’est, à mes yeux, un changement gratuit qui ne semble 2. On l’a effectivement supprimée.
33
DÉPART VERS L’AMÉRIQUE Jonas Rosales. Comment situez-vous Rebecca dans la carrière d’Hitchcock ? Il s’agit d’une œuvre charnière dans sa filmographie.
LA PROJECTION PERMANENTE À PROPOS DE REBECCA Jean Douchet
Jean Douchet. À l’époque, il n’y avait pas tellement de grands cinéastes anglais, seulement deux ou trois. C’est surtout Hitchcock qui, de 1930 à 1940, tient la première place. Mais il reste un cinéaste anglais et il en souffre parce qu’il sait qu’il est meilleur que ça. On sait qu’au fond il désirait aller aux États-Unis mais être appelé par les États-Unis et non pas avoir à demander. Il voulait être quelqu’un qu’on appelle. Et c’est justement ce qui s’est passé : c’est Selznick qui l’a appelé. Son problème, c’était de faire son entrée à Hollywood. Comme il savait qu’il n’était pas américain, qu’il n’était pas encore capable de faire du cinéma purement « américain », il fallait qu’il entre en tant que cinéaste anglais avec un film qui soit très british. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quel point Hitchcock a joué sur ce côté british en arrivant en Amérique, alors que lorsqu’il était en Angleterre, il était « anti-anglais ». Ce qu’il aimait alors, c’était montrer la vulgarité anglaise – et il le prouvera de façon évidente quand il retournera tourner à Londres son avant-dernier film, Frenzy, où la vulgarité anglaise réapparaîtra de façon très forte. Alors que, à son arrivée aux États-Unis, il joue sur son côté très british, très dandy. Et il va transformer cette idée du dandysme en faisant de tous ses assassins des dandys, des snobs. C’est ainsi qu’Hitchcock acquiert une certaine réputation à Hollywood, celle du cinéaste anglais par excellence. Mais en même temps, il est intéressant de voir que cette idée de l’Angleterre lui déplaît profondément. Et cela est visible dès Rebecca. Le véritable sujet de ce film, c’est une femme de la classe très moyenne qui entre dans le très grand monde. Elle est en état d’infériorité, de peur, et elle va finalement accéder à cette classe non pas en se pliant à son nouveau milieu mais en étant elle-même. C’est ce jeu-là que joue Hitchcock.
LE PERSONNAGE DE REBECCA J. Douchet. On observe dans le film une double représentation de l’Autre Femme incarnée par Rebecca – soit la British totale – par des femmes qui n’appartiennent pas au monde de l’aristocratie. La première, c’est Mme Van Hopper, celle qui joue à la snob mais qui n’en est pas une, à son grand regret. Sa projection, toute en vulgarité et en grossièreté, fait face à celle de Mme Danvers,
68
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
69
DÉPART VERS L’AMÉRIQUE Jonas Rosales. Comment situez-vous Rebecca dans la carrière d’Hitchcock ? Il s’agit d’une œuvre charnière dans sa filmographie.
LA PROJECTION PERMANENTE À PROPOS DE REBECCA Jean Douchet
Jean Douchet. À l’époque, il n’y avait pas tellement de grands cinéastes anglais, seulement deux ou trois. C’est surtout Hitchcock qui, de 1930 à 1940, tient la première place. Mais il reste un cinéaste anglais et il en souffre parce qu’il sait qu’il est meilleur que ça. On sait qu’au fond il désirait aller aux États-Unis mais être appelé par les États-Unis et non pas avoir à demander. Il voulait être quelqu’un qu’on appelle. Et c’est justement ce qui s’est passé : c’est Selznick qui l’a appelé. Son problème, c’était de faire son entrée à Hollywood. Comme il savait qu’il n’était pas américain, qu’il n’était pas encore capable de faire du cinéma purement « américain », il fallait qu’il entre en tant que cinéaste anglais avec un film qui soit très british. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quel point Hitchcock a joué sur ce côté british en arrivant en Amérique, alors que lorsqu’il était en Angleterre, il était « anti-anglais ». Ce qu’il aimait alors, c’était montrer la vulgarité anglaise – et il le prouvera de façon évidente quand il retournera tourner à Londres son avant-dernier film, Frenzy, où la vulgarité anglaise réapparaîtra de façon très forte. Alors que, à son arrivée aux États-Unis, il joue sur son côté très british, très dandy. Et il va transformer cette idée du dandysme en faisant de tous ses assassins des dandys, des snobs. C’est ainsi qu’Hitchcock acquiert une certaine réputation à Hollywood, celle du cinéaste anglais par excellence. Mais en même temps, il est intéressant de voir que cette idée de l’Angleterre lui déplaît profondément. Et cela est visible dès Rebecca. Le véritable sujet de ce film, c’est une femme de la classe très moyenne qui entre dans le très grand monde. Elle est en état d’infériorité, de peur, et elle va finalement accéder à cette classe non pas en se pliant à son nouveau milieu mais en étant elle-même. C’est ce jeu-là que joue Hitchcock.
LE PERSONNAGE DE REBECCA J. Douchet. On observe dans le film une double représentation de l’Autre Femme incarnée par Rebecca – soit la British totale – par des femmes qui n’appartiennent pas au monde de l’aristocratie. La première, c’est Mme Van Hopper, celle qui joue à la snob mais qui n’en est pas une, à son grand regret. Sa projection, toute en vulgarité et en grossièreté, fait face à celle de Mme Danvers,
68
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
69
qui elle est une admiratrice totale de l’aristocratie, qui ne voit que sa perfection absolue incarnée par Rebecca. Ce personnage devient obsessionnel et gagne en intérêt puisqu’Hitchcock va le transformer en une sorte de démon, de fantôme. Tout l’enjeu va être de transcrire cela par l’écriture cinématographique, à travers les jeux d’ombre et de lumière – une relecture de l’expressionnisme « à la sauce anglaise ». Dès le générique nous sont donnés les ingrédients qui vont composer le film : l’ombre et la lumière, le noir et le blanc, les nuages, les brumes… Avec, comme toujours chez Hitchcock, l’idée que le bien n’est pas forcément incarné par le blanc, et inversement. On le voit très clairement lorsque notre héroïne – qui n’a ni nom ni prénom, qui n’est rien – va s’habiller pour le bal et qu’elle met la robe de Rebecca, entièrement blanche. Mme Danvers, toute de noir vêtue, lui dit de mettre cette robe blanche, sachant que cela aboutira à sa destruction. Qu’elle ne pourra en aucun cas être rivale de Rebecca. Mais en même temps, Rebecca est une femme profondément méchante, froide, qui n’a aucune humanité. Elle est en quelque sorte l’incarnation du Mal. J. Rosales. Rebecca est un personnage qui n’existe pas physiquement dans le film, c’est un esprit. Pourrait-on parler de « film de fantôme » ? J. Douchet. Ce ne sont pas des fantômes chez Hitchcock mais des existences mentales. Rebecca a bien existé, mais cette existence n’a aucun intérêt si ce n’est qu’elle a été la lady parfaite. Une femme odieuse qu’on déteste, mais qu’en même temps tout le monde aime parce que c’est quand même une grande lady. En revanche, ce personnage qui a existé mais qui n’existe plus, ce n’est pas son fantôme qui est là. C’est l’idée même d’une classe sociale dans sa représentation qui va provoquer un complexe d’infériorité chez l’héroïne.
L’ADAPTATION DU ROMAN J. Rosales. Le film est construit en trois parties, avec le préambule du rêve. La première, qui dure près d’une demi-heure, se situe à Monte-Carlo et ressemble à une comédie de Lubitsch. La deuxième, la plus longue, constitue le cœur du film : on y découvre Manderley et ses habitants. Enfin, il y a le dénouement policier avec la découverte du deuxième corps. J. Douchet. Et là, dans la troisième partie, on se rend compte qu’il n’est pas encore le Hitchcock qu’il va devenir. Ce développement est scénaristique. Bien sûr qu’il est mis en scène et plutôt bien fait, mais c’est une mise en scène
70
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
explicative et non créatrice. Et on résout le problème policier. Heureusement que le film se termine par l’incendie et par l’admirable plan de Mme Danvers dans les flammes. J. Rosales. On sait toutefois que le rapport de forces avec Selznick a été très difficile. Comme c’était un roman qui avait eu un immense succès à l’époque, il tenait à ce que les gens retrouvent l’histoire telle quelle. J. Douchet. Il voulait « l’adaptation ». J. Rosales. Le générique commence par ces mots : « Selznick International presents its picturization of Daphne du Maurier’s celebrated novel ». Le message est sans équivoque : « Selznick vous présente la mise en images du célèbre roman de Daphné du Maurier ». J. Douchet. C’est-à-dire une adaptation exacte. Mais il existe en parallèle une critique sous-jacente de l’aristocratie anglaise. Hitchcock condamne ce monde de la gentry qui est selon lui un monde inhumain, inacceptable, qui fait de l’Angleterre – du moins à cette époque-là – un pays invivable au quotidien. J. Rosales. Daphné du Maurier appréciait beaucoup Rebecca mais n’aimait pas du tout l’adaptation d’Hitchcock de sa nouvelle Les Oiseaux. J. Douchet. Parce qu’avec Rebecca, elle avait l’impression qu’on avait respecté son œuvre. Or lorsqu’Hitchcock va adapter Les Oiseaux, il ne restait plus rien de la nouvelle de Daphné du Maurier. J. Rosales. Le cinéaste a également pris beaucoup de libertés dans La Taverne de la Jamaïque, son dernier film anglais avant son départ à Hollywood. Car Hitchcock a enchaîné deux adaptations de Daphné du Maurier. J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’Hitchcock courait après le succès, or Daphné du Maurier était reconnue comme une auteure à succès. J. Rosales. Dans ses entretiens avec Hitchcock, Truffaut lui dit qu’il considère Rebecca comme un sujet qui lui est lointain. Ce qui est intéressant, c’est qu’Hitchcock lui répond qu’il avait déjà eu l’idée d’adapter le roman en Angleterre mais qu’il n’avait pas eu les droits en raison du surcoût du projet. Il s’agit d’une coïncidence assez surprenante…
71
qui elle est une admiratrice totale de l’aristocratie, qui ne voit que sa perfection absolue incarnée par Rebecca. Ce personnage devient obsessionnel et gagne en intérêt puisqu’Hitchcock va le transformer en une sorte de démon, de fantôme. Tout l’enjeu va être de transcrire cela par l’écriture cinématographique, à travers les jeux d’ombre et de lumière – une relecture de l’expressionnisme « à la sauce anglaise ». Dès le générique nous sont donnés les ingrédients qui vont composer le film : l’ombre et la lumière, le noir et le blanc, les nuages, les brumes… Avec, comme toujours chez Hitchcock, l’idée que le bien n’est pas forcément incarné par le blanc, et inversement. On le voit très clairement lorsque notre héroïne – qui n’a ni nom ni prénom, qui n’est rien – va s’habiller pour le bal et qu’elle met la robe de Rebecca, entièrement blanche. Mme Danvers, toute de noir vêtue, lui dit de mettre cette robe blanche, sachant que cela aboutira à sa destruction. Qu’elle ne pourra en aucun cas être rivale de Rebecca. Mais en même temps, Rebecca est une femme profondément méchante, froide, qui n’a aucune humanité. Elle est en quelque sorte l’incarnation du Mal. J. Rosales. Rebecca est un personnage qui n’existe pas physiquement dans le film, c’est un esprit. Pourrait-on parler de « film de fantôme » ? J. Douchet. Ce ne sont pas des fantômes chez Hitchcock mais des existences mentales. Rebecca a bien existé, mais cette existence n’a aucun intérêt si ce n’est qu’elle a été la lady parfaite. Une femme odieuse qu’on déteste, mais qu’en même temps tout le monde aime parce que c’est quand même une grande lady. En revanche, ce personnage qui a existé mais qui n’existe plus, ce n’est pas son fantôme qui est là. C’est l’idée même d’une classe sociale dans sa représentation qui va provoquer un complexe d’infériorité chez l’héroïne.
L’ADAPTATION DU ROMAN J. Rosales. Le film est construit en trois parties, avec le préambule du rêve. La première, qui dure près d’une demi-heure, se situe à Monte-Carlo et ressemble à une comédie de Lubitsch. La deuxième, la plus longue, constitue le cœur du film : on y découvre Manderley et ses habitants. Enfin, il y a le dénouement policier avec la découverte du deuxième corps. J. Douchet. Et là, dans la troisième partie, on se rend compte qu’il n’est pas encore le Hitchcock qu’il va devenir. Ce développement est scénaristique. Bien sûr qu’il est mis en scène et plutôt bien fait, mais c’est une mise en scène
70
explicative et non créatrice. Et on résout le problème policier. Heureusement que le film se termine par l’incendie et par l’admirable plan de Mme Danvers dans les flammes. J. Rosales. On sait toutefois que le rapport de forces avec Selznick a été très difficile. Comme c’était un roman qui avait eu un immense succès à l’époque, il tenait à ce que les gens retrouvent l’histoire telle quelle. J. Douchet. Il voulait « l’adaptation ». J. Rosales. Le générique commence par ces mots : « Selznick International presents its picturization of Daphne du Maurier’s celebrated novel ». Le message est sans équivoque : « Selznick vous présente la mise en images du célèbre roman de Daphné du Maurier ». J. Douchet. C’est-à-dire une adaptation exacte. Mais il existe en parallèle une critique sous-jacente de l’aristocratie anglaise. Hitchcock condamne ce monde de la gentry qui est selon lui un monde inhumain, inacceptable, qui fait de l’Angleterre – du moins à cette époque-là – un pays invivable au quotidien. J. Rosales. Daphné du Maurier appréciait beaucoup Rebecca mais n’aimait pas du tout l’adaptation d’Hitchcock de sa nouvelle Les Oiseaux. J. Douchet. Parce qu’avec Rebecca, elle avait l’impression qu’on avait respecté son œuvre. Or lorsqu’Hitchcock va adapter Les Oiseaux, il ne restait plus rien de la nouvelle de Daphné du Maurier. J. Rosales. Le cinéaste a également pris beaucoup de libertés dans La Taverne de la Jamaïque, son dernier film anglais avant son départ à Hollywood. Car Hitchcock a enchaîné deux adaptations de Daphné du Maurier. J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’Hitchcock courait après le succès, or Daphné du Maurier était reconnue comme une auteure à succès. J. Rosales. Dans ses entretiens avec Hitchcock, Truffaut lui dit qu’il considère Rebecca comme un sujet qui lui est lointain. Ce qui est intéressant, c’est qu’Hitchcock lui répond qu’il avait déjà eu l’idée d’adapter le roman en Angleterre mais qu’il n’avait pas eu les droits en raison du surcoût du projet. Il s’agit d’une coïncidence assez surprenante…
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
71
J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’il y a chez Hitchcock un côté irlandais, catholique. En effet, il y a chez lui une réserve sur cette société anglaise protestante et son hypocrisie profonde. Ce qui agace fondamentalement Hitchcock, c’est cette hypocrisie. Il voulait la démontrer. S’il avait tourné en Angleterre, je crois qu’il n’aurait pas eu la liberté d’être aussi violent que dans ce film. Il démolit totalement l’intrigue. Tout à l’heure, je parlais du générique en tant que tel : les ombres, les lumières, la forêt, le chemin… Comment ce grand chemin qui menait au château est devenu un petit chemin de rien du tout. Hitchcock organise la destruction de cet univers fictif. Ensuite il y a la scène de la rencontre au sommet de la falaise. Le personnage de Maxim rejette tout de suite l’héroïne, avec une violence extrême. En d’autres termes : « Je ne veux pas de femme, foutez-moi le camp ! ». Immédiatement après, il lui fait la cour. D’un point de vue scénaristique, c’est un peu curieux. Mais en même temps, cela montre que le personnage de Maxim est avant tout un aristocrate. D’emblée, il la traite avec mépris… en tant qu’aristocrate ! C’est lui qui domine – qu’il veuille se jeter de la falaise est présupposé. Il y a aussi une image récurrente dans le film : celle de la mer qui avance avec fureur. Comme si, face à la vie réelle, il y avait cette volonté de refuser cette vie pour imposer son soi. C’est ça qui est frappant, alors que cette héroïne n’a rien à faire dans ce monde. Elle intéresse Maxim parce qu’elle est celle qui n’est pas de ce monde et qu’il peut l’amener dans son monde. Surtout, il ne veut pas la reconnaître en Rebecca. Elle ne peut pas être Rebecca ! J. Rosales. Il y a quelques petits détails qui ne figurent pas dans le livre. Je pense à deux séquences en particulier qui ne sont pas dans le roman mais sont pourtant assez significatives. La première, c’est l’histoire que raconte l’héroïne au restaurant lorsqu’elle parle de son père et dit qu’il peignait toujours le même arbre. J. Douchet. C’est une confession d’Hitchcock. Il n’a toujours peint qu’une seule chose : l’état de dépendance d’un imaginaire par rapport au réel. Comment l’imaginaire veut transformer le réel. Le propre même du cinéma. Il le traite d’une façon maladive, perverse. J. Rosales. Ce dialogue n’apporte rien à l’intrigue. J. Douchet. En revanche, il dit. C’est une déclaration d’auteur. J. Rosales. L’autre scène qui n’est pas dans le roman, c’est le passage où Maxim
72
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
projette les films de leur voyage de noces, les home movies. J. Douchet. Et d’un seul coup, enfin, il met le cinéma en dominante et non plus en second. Ce qu’il va malheureusement faire dans la fin du film où le cinéma ne fait que suivre le scénario. Alors que là, d’un seul coup, le cinéma prend place et entre dans l’espace. Les personnages sont dans le cinéma, et non plus à l’extérieur. J. Rosales. C’est une séquence extrêmement sophistiquée du point de vue de la mise en scène. J. Douchet. Forcément puisque là, il reconstruit le cinéma et que le cinéma envahit l’espace réel. On est dans le mouvement de l’imaginaire donc dans ce moment où le spectateur projette. On est dans la projection du spectateur, sauf que les personnages sont dans la projection.
UN FILM AU FÉMININ J. Rosales. Rebecca est un film qui épouse le point de vue d’une femme. J. Douchet. Qui épouse le point de vue des femmes. La première, c’est la bourgeoise enrichie, la « moi, j’ai » – « Moi j’ai et tout le monde m’obéit parce que j’ai. » Elle possède une vision du monde terriblement marchande car, au fond, Mme Van Hopper est une commerçante. C’est une féminité qui a perdu toute féminité. Ce personnage va avoir sa projection, son double, en Mme Danvers. Les deux femmes sont dans l’admiration, mais cela se joue de façon beaucoup plus complexe chez la gouvernante. Car celle-ci admire en même temps qu’elle aime. Or si elle aime, elle désire. Il existe, comme souvent chez Hitchcock, un soupçon d’homosexualité. Il est évident que Mme Danvers était folle d’amour pour Rebecca. Donc l’autre femme, l’héroïne, ne peut être que rien. Rebecca était la femme sociabilisée et en même temps totalement idéalisée, la femme parfaite. Celle que l’on désire. De ce point de vue, ça devient une rivalité amoureuse. Mais elle est une amoureuse très étrange, très hitchcockienne : une femme amoureuse d’une femme face à une autre femme amoureuse d’un homme. Et l’homme que l’on croit avoir été amoureux de la femme divinisée est en réalité amoureux de la femme faible parce que, à ce moment-là, il a face à lui quelqu’un de faible, comme lui, qu’il peut aimer. Mais il y a aussi un autre personnage féminin très intéressant dans le film, c’est celui de la sœur. Elle est plus sympathique, ce qui
73
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
David O. Selznick et Alfred Hitchcock.
42
43
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
92
93
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
104
105
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
162
163
HITCHCOCK BOGDANOVICH DIVERS CHABROL LEXIQUE
258 266
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
259 267
Vous ne regardez jamais vos films avec un public. Cela ne vous manque pas d’entendre les spectateurs crier ? Non. Je les entends crier quand je tourne mes films. – Alfred Hitchcock
HITCHCOCK/BOGDANOVICH ENTRETIEN
Dans l’histoire du cinéma, Alfred Hitchcock occupe une position unique : c’est le seul réalisateur (à la possible exception de Cecil B. DeMille) dont le nom fait apparaître une image spécifique dans l’esprit du spectateur moyen (là aussi, si l’on excepte des acteurs-réalisateurs tels que Chaplin, dont la popularité repose sur leur performance en tant que comédien plutôt que sur leur œuvre derrière la caméra). C’est le seul réalisateur actuel dont les films sont vendus sur son seul nom, un nom devenu synonyme, dans l’inconscient collectif, d’un certain type de film. On parle de film hitchcockien plus que d’un film d’Hitchcock. Le genre dans lequel il œuvre, au sens large (thrillers, films policiers, comédies macabres, films à suspense) est considéré par les critiques américains comme peu respectable et dénué de valeur artistique. En Angleterre, ce type de film est sophistiqué et respecté. En fait, comme il le reconnaît lui-même, Hitchcock a une personnalité mêlant nettement l’humour britannique et le dynamisme américain. Dans le cinéma anglais, il est le seul réalisateur digne d’intérêt, l’unique contribution de ce pays au septième art. Cependant, cela fait 23 ans qu’il travaille aux États-Unis. Plus de la moitié de sa carrière s’est déroulée dans ce pays. De plus, comme il aime à le rappeler, il a forgé son expérience et appris les rudiments de son métier grâce aux Américains. Par conséquent, on ne peut plus le qualifier de réalisateur britannique, si tant est qu’on ait pu le faire un jour. Selon tous les critères (sauf son ironie et son étrange sens de l’humour), c’est un artiste américain, à l’instar de Chaplin, en dépit de son lieu de naissance. Avez-vous le sentiment que le cinéma américain est toujours le plus important de tous ? À l’échelle de la planète, oui1. En effet, quand nous faisons des films pour les ÉtatsUnis, nous les faisons automatiquement pour le monde entier, parce que ce pays est rempli d’étrangers. C’est un melting pot. Cela m’amène à aborder un autre point. Je ne sais pas ce qu’on désigne par l’expression « films hollywoodiens ». Je réponds à cela par une question : « Où sont-ils donc conçus ? » Regardez cette pièce : on ne peut pas regarder par les fenêtres. Nous pourrions tout aussi bien être dans une chambre d’hôtel à Londres, ou n’importe où ailleurs. Voilà l’endroit où l’on écrit les scénarios. Et ensuite, où allons-nous ? Tourner en décors réels, soit, mais sinon, où travaillons-nous ? Sur un plateau de tournage, fermé par de grandes portes.
260
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
1. Toutes les remarques et les réponses de M. Hitchcock sont tirées d’une longue interview qu’il m’a accordée, enregistrée au magnétophone les 12, 13 et 14 février à ses bureaux des studios Universal, à Hollywood.
261
Vous ne regardez jamais vos films avec un public. Cela ne vous manque pas d’entendre les spectateurs crier ? Non. Je les entends crier quand je tourne mes films. – Alfred Hitchcock
HITCHCOCK/BOGDANOVICH ENTRETIEN
Dans l’histoire du cinéma, Alfred Hitchcock occupe une position unique : c’est le seul réalisateur (à la possible exception de Cecil B. DeMille) dont le nom fait apparaître une image spécifique dans l’esprit du spectateur moyen (là aussi, si l’on excepte des acteurs-réalisateurs tels que Chaplin, dont la popularité repose sur leur performance en tant que comédien plutôt que sur leur œuvre derrière la caméra). C’est le seul réalisateur actuel dont les films sont vendus sur son seul nom, un nom devenu synonyme, dans l’inconscient collectif, d’un certain type de film. On parle de film hitchcockien plus que d’un film d’Hitchcock. Le genre dans lequel il œuvre, au sens large (thrillers, films policiers, comédies macabres, films à suspense) est considéré par les critiques américains comme peu respectable et dénué de valeur artistique. En Angleterre, ce type de film est sophistiqué et respecté. En fait, comme il le reconnaît lui-même, Hitchcock a une personnalité mêlant nettement l’humour britannique et le dynamisme américain. Dans le cinéma anglais, il est le seul réalisateur digne d’intérêt, l’unique contribution de ce pays au septième art. Cependant, cela fait 23 ans qu’il travaille aux États-Unis. Plus de la moitié de sa carrière s’est déroulée dans ce pays. De plus, comme il aime à le rappeler, il a forgé son expérience et appris les rudiments de son métier grâce aux Américains. Par conséquent, on ne peut plus le qualifier de réalisateur britannique, si tant est qu’on ait pu le faire un jour. Selon tous les critères (sauf son ironie et son étrange sens de l’humour), c’est un artiste américain, à l’instar de Chaplin, en dépit de son lieu de naissance. Avez-vous le sentiment que le cinéma américain est toujours le plus important de tous ? À l’échelle de la planète, oui1. En effet, quand nous faisons des films pour les ÉtatsUnis, nous les faisons automatiquement pour le monde entier, parce que ce pays est rempli d’étrangers. C’est un melting pot. Cela m’amène à aborder un autre point. Je ne sais pas ce qu’on désigne par l’expression « films hollywoodiens ». Je réponds à cela par une question : « Où sont-ils donc conçus ? » Regardez cette pièce : on ne peut pas regarder par les fenêtres. Nous pourrions tout aussi bien être dans une chambre d’hôtel à Londres, ou n’importe où ailleurs. Voilà l’endroit où l’on écrit les scénarios. Et ensuite, où allons-nous ? Tourner en décors réels, soit, mais sinon, où travaillons-nous ? Sur un plateau de tournage, fermé par de grandes portes. 1. Toutes les remarques et les réponses de M. Hitchcock sont tirées d’une longue interview qu’il m’a accordée, enregistrée au magnétophone les 12, 13 et 14 février à ses bureaux des studios Universal, à Hollywood. REPRODUCTION INTERDITE
260
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
261
C’est comme une mine de charbon : nous ne savons même pas quel temps il fait dehors. Je le répète, nous ne savons pas où nous sommes. Nous sommes uniquement à l’intérieur du film, de cette chose que nous fabriquons. C’est pour cela qu’il est absurde de raisonner en termes géographiques. « Hollywood »… Cela ne signifie rien pour moi. Quand on me demande pourquoi j’aime travailler à Hollywood, je réponds : « Parce que je peux rentrer chez moi à 18 h, pour le dîner. » Les critiques de cinéma ont tendance à dire que son « âge d’or » correspond aux films de sa période anglaise allant du premier Homme qui en savait trop (1934) à Une femme disparaît (1938), c’est-à-dire juste avant son arrivée aux États-Unis. C’est sans doute en Angleterre que cette opinion vit le jour, puisqu’avec les six films qu’il réalisa au cours de ces quatre années, ainsi que The Lodger (1926) et Chantage (1929), on tient là de toute évidence les huit meilleurs films jamais faits dans ce pays : leur dynamisme, leur inventivité, leur forte personnalité et leurs qualités cinématographiques n’ont jamais été égalés par un réalisateur anglais, avant ou après. En un sens, c’est par autodéfense que les Anglais déclarèrent qu’Hitchcock avait cédé aux sirènes des États-Unis, s’était coupé de ses racines et avait gâché son talent. Au bout de quelques années, une fois que le motif peu avouable de cette accusation fut tombé dans l’oubli, les snobs américains reprirent cette séduisante théorie du « déclin d’Hitchcock » et se l’approprièrent. Parallèlement, la popularité d’Hitchcock n’a cessé de croître. C’est l’une de ces heureuses situations où le public a eu entièrement raison. En vérité, les films américains d’Hitchcock n’ont pas seulement touché un public plus large, mais ils sont aussi beaucoup plus personnels et aboutis, plus contrôlés et originaux, plus ingénieux et sérieux que tout ce qu’il a pu faire pendant son « âge d’or ». La seule excuse pardonnable pour continuer à préférer sa production anglaise à ses films américains est la nostalgie, et encore. Comment définiriez-vous le cinéma pur ? Le cinéma pur, c’est l’assemblage de morceaux de film complémentaires, tout comme une mélodie est constituée de notes de musique. Je distingue deux utilisations principales du montage : pour créer des idées et pour créer de la violence ou des émotions. Par exemple, à la fin de Fenêtre sur cour, lorsque James Stewart est jeté par la fenêtre, j’ai construit cette séquence avec des plans de pied, de jambe, de bras, de tête. C’est uniquement du montage. J’avais aussi filmé l’action entière de loin, mais cela n’avait rien à voir. Cela n’a jamais rien à voir. Prenez une bagarre de saloon, dans un western : un personnage met son adversaire hors combat, ou le propulse contre une table qui se brise sous l’impact,
262
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
comme de bien entendu. Eh bien, les séquences de ce genre sont systématiquement filmées de loin. Pourtant, elles sont plus efficaces si on les construit au montage, parce qu’on implique davantage le public. Voilà le secret de ce type de montage au cinéma. L’autre type de montage, évidemment, consiste à juxtaposer des images reliées à l’esprit d’un individu. On voit un homme regarder quelque chose, on voit ce qu’il regarde, puis on revient sur lui. On peut le faire réagir de différentes manières. On peut le montrer regarder une chose, puis une autre. Sans qu’il parle, on peut montrer son esprit fonctionner, comparer des choses. C’est la liberté absolue. Je dirais que le pouvoir du montage et de l’assemblage des images est infini. Par exemple, dans Les Oiseaux, lorsque la caméra se rapproche de l’homme énucléé, les sautes correspondent à une respiration saccadée. Est-ce bien cela ? Halètement… Halètement… Oui. Certains jeunes réalisateurs se disent : « On va transformer la caméra en personnage et la faire se déplacer comme un être humain, puis on va la placer devant un miroir pour qu’on voie de qui il s’agit. » C’est une énorme erreur. Robert Montgomery a fait ça dans La Dame du lac (1947), mais personnellement, je n’arrive pas à y croire. Que croit-on faire avec ça ? On cache aux spectateurs l’identité du personnage. Pourquoi ? C’est tout ce que ça produit. Pourquoi ne pas montrer de qui il s’agit ? Hitchcock a traversé plusieurs phases pendant sa période américaine, essayant sans cesse de nouveaux effets, relevant de nouveaux défis, approfondissant sa vision du monde. Dans Rebecca (1940), la caméra est plus fluide que dans ses films précédents ; le montage (la clé de son style) n’y est pas abandonné, mais le travelling est mis en avant, tout comme dans La Maison du docteur Edwardes (1945), Les Enchaînés (1946) et Le Procès Paradine (1947). Cette tendance culmine dans La Corde (1948), où il n’y a aucune coupe. On peut décrire le film comme un seul long plan, à cause du mouvement constant de la caméra. (En réalité, il y a huit plans de dix minutes, un par bobine de film.) L’utilisation la plus efficace de cette technique est peut-être dans Les Amants du Capricorne (1949), un virage dans sa carrière (un film d’époque qui n’est pas vraiment un thriller). Ce fut un échec commercial, sans doute parce qu’Hitchcock faisait là un film inattendu de sa part. (Depuis, il a déclaré qu’il n’aimait pas les « films en costume », parce qu’il « ne peut pas imaginer un personnage de films en costume allant aux toilettes ».) Quelle est votre méthode de tournage ? Eh bien, je ne regarde jamais dans l’objectif, vous savez. L’opérateur me connaît suffisamment pour savoir ce que je veux, et en cas de doute, je trace un rectangle et je lui dessine à quoi doit ressembler le plan. L’important, tout d’abord, c’est qu’on
263
LEXIQUE MYTHOLOGIQUE POUR L’ŒUVRE DE HITCHCOCK Philippe Demonsablon
Et d’abord, pourquoi ce lexique ? Que l’on le voie pas, dans le recensement ici entrepris, un dithyrambe de plus, avec un rien de pédant. Et pas davantage un exercice comparable à celui de ces Hindous dont on dit qu’ils prennent le nom de Dieu, car ils s’occupent à répéter sans cesse « Dieu, Dieu, Dieu ». Bref ce lexique prise assez peu les vertus de l’énumération et ne se connaît pas de dette envers l’idée de tout réduire en un classement. Ailleurs est son propos. La création chez Hitchcock reste suspendue entre le réalisme et l’abstraction ; elle tend à l’abstrait par l’attention inaccoutumée qu’elle porte au concret. Aux thèmes dramatiques qu’elle explicite, elle superpose certains éléments plastiques et, par leur biais, introduit à nouveau ces thèmes avec plus de généralité et plus de précision. De tels éléments ne sont plus des accessoires et ne sont pas des symboles, au sens qui voudrait les traduire mot à mot ; ce sont plutôt des images autour desquelles la création s’organise pour réaliser la synthèse expressive de certains thèmes. Ce lexique se propose d’aider à préciser ces images pour distinguer en elles la part de l’ornement et la part de mythologie.
BIJOUX
Leur beauté séduit et peut servir d’appât, car ils sont le plus souvent un piège. Mais ils fixent aussi quelque endroit par où saisir ceux qui les portent ; ce sont des anses, des poignées. Ils manifestent la dépendance.
ALLIANCE
THE RING : Scène du mariage : Carl Brisson passe l’alliance au doigt de Lillian Hall-Davis. REAR WINDOW : Grace Kelly porte au doigt l’alliance de la femme assassinée et la montre à distance à James Stewart.
BAGUE
SHADOW OF A DOUBT : 1° Joseph Cotten enfile l’émeraude volée au doigt de Teresa Wright. 2° Dans la scène du bar, Teresa Wright rend à Cotten l’émeraude qu’elle ne porte plus. 3° Après la seconde tentative de meurtre, Teresa Wright porte à nouveau la bague. Et aussi : la veuve joyeuse rencontrant Cotten à la banque le regarde en remuant du doigt sa bague.
BRACELET
THE RING : 1° Ian Hunter enfile le bracelet au bras de Lillian Hall-Davis ; tout au long du film elle le cache de sa main pour le découvrir à Ian Hunter. 2° Carl Brisson ôte le bracelet et l’enfile au doigt de Lillian Hall-Davis, comme une alliance.
278
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
Ce lexique a été publié dans les Cahiers du Cinéma en 1956 et traite des films jusqu’à cette date. Les titres des films, tous cités en anglais, ont été conservés.
279
LEXIQUE MYTHOLOGIQUE POUR L’ŒUVRE DE HITCHCOCK Philippe Demonsablon
Et d’abord, pourquoi ce lexique ? Que l’on le voie pas, dans le recensement ici entrepris, un dithyrambe de plus, avec un rien de pédant. Et pas davantage un exercice comparable à celui de ces Hindous dont on dit qu’ils prennent le nom de Dieu, car ils s’occupent à répéter sans cesse « Dieu, Dieu, Dieu ». Bref ce lexique prise assez peu les vertus de l’énumération et ne se connaît pas de dette envers l’idée de tout réduire en un classement. Ailleurs est son propos. La création chez Hitchcock reste suspendue entre le réalisme et l’abstraction ; elle tend à l’abstrait par l’attention inaccoutumée qu’elle porte au concret. Aux thèmes dramatiques qu’elle explicite, elle superpose certains éléments plastiques et, par leur biais, introduit à nouveau ces thèmes avec plus de généralité et plus de précision. De tels éléments ne sont plus des accessoires et ne sont pas des symboles, au sens qui voudrait les traduire mot à mot ; ce sont plutôt des images autour desquelles la création s’organise pour réaliser la synthèse expressive de certains thèmes. Ce lexique se propose d’aider à préciser ces images pour distinguer en elles la part de l’ornement et la part de mythologie.
BIJOUX
Leur beauté séduit et peut servir d’appât, car ils sont le plus souvent un piège. Mais ils fixent aussi quelque endroit par où saisir ceux qui les portent ; ce sont des anses, des poignées. Ils manifestent la dépendance.
ALLIANCE
THE RING : Scène du mariage : Carl Brisson passe l’alliance au doigt de Lillian Hall-Davis. REAR WINDOW : Grace Kelly porte au doigt l’alliance de la femme assassinée et la montre à distance à James Stewart.
BAGUE
SHADOW OF A DOUBT : 1° Joseph Cotten enfile l’émeraude volée au doigt de Teresa Wright. 2° Dans la scène du bar, Teresa Wright rend à Cotten l’émeraude qu’elle ne porte plus. 3° Après la seconde tentative de meurtre, Teresa Wright porte à nouveau la bague. Et aussi : la veuve joyeuse rencontrant Cotten à la banque le regarde en remuant du doigt sa bague.
BRACELET
THE RING : 1° Ian Hunter enfile le bracelet au bras de Lillian Hall-Davis ; tout au long du film elle le cache de sa main pour le découvrir à Ian Hunter. 2° Carl Brisson ôte le bracelet et l’enfile au doigt de Lillian Hall-Davis, comme une alliance.
Ce lexique a été publié dans les Cahiers du Cinéma en 1956 et traite des films jusqu’à cette date. Les titres des films, tous cités en anglais, ont été conservés.
278
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
279
3
CHEF D’ORCHESTRE ET MAÎTRE DE MARIONNETTES (Fabien Delmas) REBECCA
un télex de selznick à hitchcock (Nicolas Saada) selznick, le producteur donne la note dans le hall des rois mogols (Alfred Hitchcock) sans tambour ni trompette (Claude Chabrol) l’absente (Nathalie Heinich) la projection permanente (Jean Douchet)
Crédits photographiques Couverture et photos des pages 43-48, 49 (haut), 50, 52, 53, 91-95, 98-100, 101 (bas), 102-108, 157170, 172, 173, 203, 205, 206, 207, 208 (haut), 239, 240 (haut), 242, 243, 244 (bas), 246-250, 251 (haut), 252 et 253 (haut) : INDEPENDENT VISIONS/MPTV. Tous droits réservés. Photos et illustrations des pages 49 (bas), 96, 97, 109 (bas), 110, 111, 171, 201, 202, 204, 209, 240 (bas), 241, 245, 254 et 255. Reproduites avec l’aimable autorisation de The Alfred Hitchcock Collection de The Academy Film Archive. Photos des pages 51, 101 (haut), 109 (haut), 200 (haut), 208 (bas) et 244 (haut). Reproduites avec l’aimable autorisation de Laurent Bouzereau. Page 63 (haut) : © UNITED ARTISTS. Tous droits réservés. Pages 63 (bas), 66 et 67 : © 1940 DAVID O. SELZNICK © ABC, Inc. Tous droits réservés. Pages 64 et 65 : © SELZNICK INTERNATIONAL PICTURES. Tous droits réservés. Pages 143-149 : © ABC, Inc. Tous droits réservés. Pages 195-198, 199 (haut) et 200 (bas) : © 1946 RKO. © ABC, Inc. Tous droits réservés. Page 199 (bas) : © RKO RADIO PICTURES - RADIO-KEITH-ORPHEUM. Tous droits réservés. Pages 251 (bas), 253 (bas), 256 et 257 : © ABC, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de l’ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur et de ses ayants droit. Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce livre, malgré les soins et les contrôles, ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur. Nous adressons nos sincères excuses aux détenteurs de copyrights qui, malgré nos efforts, auraient été involontairement oubliés. Nous rectifierons ces éventuelles erreurs lors de la prochaine édition de cet ouvrage, dans la mesure elles nous auront été signalées.
page 9 page 25 page 26 page 30 page 36 page 54 page 58 page 68
LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES
page 81
LES ENCHAÎNÉS
page 151
LE PROCÈS PARADINE
page 211
la touche hitchcock (Alfred Hitchcock) page 82 le thriller de cinéma (Alfred Hitchcock) page 86 la part du rêve (Nathalie Bondil) page 112 hitchcock, artiste malgré lui (Nathalie Bondil) page 130
notorious [alfred hitchcock] (Pascal Bonitzer) page 152 alicia au pays des dragons (Frank Lafond) page 174
seuls ensemble… (Benjamin Thomas) page 212
HITCHCOCK, BOGDANOVICH, CHABROL, LEXIQUE page 259 hitchcock/bogdanovich page 260 hitchcock devant le mal (Claude Chabrol) page 270 lexique mythologique pour l’œuvre de hitchcock (Philippe Demonsablon) page 278 Cahiers de photographies : voir pages 43, 63, 91, 143, 157, 195 et 239 REPRODUCTION INTERDITE
6
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
7
CHEF D’ORCHESTRE ET MAÎTRE DE MARIONNETTES SUR LA RELATION ENTRE ALFRED HITCHCOCK ET DAVID O. SELZNICK Fabien Delmas
8
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
9
La collaboration entre Alfred Hitchcock et David O. Selznick est emblématique d’une période charnière de l’histoire du cinéma américain. Elle correspond à l’apogée et au début du déclin d’un système qui fit s’épanouir le classicisme hollywoodien. 1938-1948, soit dix années qui coïncident avec l’affranchissement progressif du pouvoir de décision des producteurs. SelznickHitchcock, c’est aussi le récit d’une association légendaire entre l’un des producteurs symbole de l’exigence d’un système hégémonique et le cinéaste des cinéastes. La politique des auteurs, la légende, qu’il a parfois complaisamment entretenue, voudraient qu’Hitchcock ait eu l’ascendant artistique sur David O. Selznick. On néglige l’importance du producteur dans l’essor de la carrière américaine d’Alfred Hitchcock et dans les changements que connut le style du cinéaste anglais lorsqu’il arriva aux États-Unis. Cette collaboration fut ponctuée par quatre films, Rebecca (1940), La Maison du docteur Edwardes (Spellbound, 1945), Les Enchaînés (Notorious, 1946) et Le Procès Paradine (The Paradine Case, 1947). À ces œuvres s’ajoutent des dizaines et des dizaines de mémos envoyés compulsivement par Selznick et qui hérissèrent tant Alfred Hitchcock. La décennie qu’Hitchcock passa dans le giron de Selznick fut plus qu’une période de transition. La collaboration, parfois frustrante, parfois étouffante, fut pourtant fructueuse et productive. En mettant à la disposition du metteur en scène son savoir-faire et celui des techniciens hollywoodiens, Selznick permit à Hitchcock de donner corps à ses visions. À la fin des années 1930, David O. Selznick était l’archétype du producteur hollywoodien. Avec Irving Thalberg, le jeune producteur vedette de la MGM, il appartenait à la deuxième génération de dirigeants hollywoodiens. Ces producteurs ne faisaient pas partie des fondateurs ou des pionniers, mais étaient parvenus à une première synthèse de pratiques et de méthodes mûries. Ils étaient initiés aux formules artistiques, économiques et pragmatiques de l’industrie. Détail qui n’en est pas un : contrairement aux pères fondateurs du cinéma américain, Selznick naquit après l’apparition du cinéma et après 1900, au moment où Broadway et Hollywood virent se concentrer et se sédentariser des activités culturelles, spectaculaires et économiques qui déterminèrent, en la symbolisant, la culture américaine du XXe siècle. À l’image de Jonathan Shields, le héros des Ensorcelés (Vincente Minnelli, 1952), Selznick faisait partie d’une dynastie cinématographique. Il était le fils de Lewis J. Selznick, fondateur de Lewis J. Selznick Production, Inc. qui prospéra avant de connaître la ruine au début des années 1930. À l’image de Jonathan Shields, Selznick bâtit son propre studio en appliquant à la fabrication de ses films des méthodes acquises à l’ombre des hangars de la Paramount (1928-1931), de la RKO (1931-1933) et de la MGM (1926-1928 puis 1933-1935). Démiurge se rêvant omnipotent, David O. Selznick était expansif, envahissant, imposant
10
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
11
et consommait des quantités invraisemblables de benzédrine pour nourrir son hyperactivité. Il était surtout un créateur obsédé par le détail, la recherche de l’excellence et l’affirmation de l’exigence d’un savoir-faire qu’il érigea en credo de sa société de Selznick International Pictures, « Dans la tradition de la qualité ». Selznick se démarqua par son instinct et son goût sûrs. Les cinéphiles doivent à son flair George Cukor, Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Vivien Leigh et Jennifer Jones. En 1935, en fondant son propre studio, Selznick donna vie à un projet aussi risqué qu’ambitieux : produire en tant qu’indépendant des films d’une qualité supérieure qui concurrenceraient ceux des principaux studios. Le nom de Selznick renvoie systématiquement aux célèbres mémos qu’il dictait fiévreusement, névrotiquement, à ses secrétaires, dans la nuit californienne, et dont il inondait l’ensemble de ses collaborateurs. S’est-on interrogé sur la volonté de conservation qui permit à ses notes de nous parvenir ? En 1965, après la mort de leur père, les fils de David O. Selznick firent don de ses archives à l’université du Texas1. Ce legs, comprenant les fameux mémos, représentait une masse de vingt-six tonnes de documents. En produisant des films tels que King Kong (RKO, 1933) ou Autant en emporte le vent (Gone with the Wind, 1939), Selznick aspira à contribuer durablement à l’histoire du cinéma dont il avait une conscience accrue. On sait, par ailleurs, que parallèlement à ses activités de producteur, il poursuivit le projet d’éditer une anthologie de scénarios et une histoire photographique du cinéma2. À ce titre, le retour sur les relations personnelles et professionnelles qu’il entretint avec Alfred Hitchcock revêt une dimension historique significative. L’entente entre les deux hommes fut fructueuse, mais continuellement ponctuée par des conflits et une méfiance réciproque qui ne fit que s’accroître. Durant dix années, au fil des projets, au fur et à mesure que l’influence de Selznick se réduisit et que son rayonnement s’accrut, Hitchcock n’eut de cesse d’aspirer à l’indépendance et au statut de producteur. Pourtant, sur le plan artistique, le récit de la collaboration entre Hitchcock et Selznick est d’abord celui d’une entente quasi-symbiotique, formidablement complémentaire. La maîtrise de l’art du récit hérité de la littérature du XIXe siècle et la profondeur apportée à la caractérisation des personnages étaient les fondements de la conception de Selznick. Ce soin accordé aux aspects narratifs du film permettait l’établissement d’une trame solide à partir de laquelle Hitchcock put expérimenter et développer un formalisme spécifique au cinéma. L’association entre Hitchcock et Selznick se développa durant une période décisive qui vit la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’entérinement du décret Paramount. Cette association fascine 1. Sylvie Pliskin, « Université du Texas à Austin : les archives de David O. Selznick », Cinémathèque n° 1 (Paris), mai 1992, p. 114. 2. Ibid. REPRODUCTION INTERDITE
12
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
parce qu’elle réunit un producteur hollywoodien qui pourrait prétendre au statut d’auteur et un cinéaste que les tenants de la politique des auteurs érigèrent en totem. Peut-être plus qu’aucun autre producteur, Selznick avait une vision totalisante de la création filmique. Il intervenait à chaque étape de l’élaboration du film. De l’écriture, au casting. Incontestablement, son royaume était la salle de montage où le producteur pouvait manier, remanier et manipuler à l’envi la matière filmique, jouant avec les multiples combinaisons narratives et rythmiques, jonglant avec la multiplicité des angles de prises de vues déterminés lors du tournage. L’une des analogies qu’il cultive le plus dans les documents qui nous sont parvenus, consiste à assimiler sa vision des fonctions de producteur à l’art d’un chef d’orchestre. L’image sied bien à Selznick qui se voyait comme un créateur dont la mission était de mettre le pragmatisme au service de l’excellence. Cette conception induit la pluridisciplinarité, la coordination entre des techniciens et des chefs de poste aguerris et, dans une mesure qui n’est pas négligeable, l’obéissance. Paradoxalement, Selznick s’est souvent attaché les services de cinéastes au style très affirmé. Ce fut le cas de King Vidor, George Cukor, William Dieterle, et, évidemment, d’Alfred Hitchcock3. Les négociations sur une collaboration entre les deux hommes débutèrent en 1936. À la fin des années 1930, avec Chantage (1930), L’Homme qui en savait trop (1934) et Une femme disparaît (1938), Alfred Hitchcock était déjà considéré comme le cinéaste le plus important d’Angleterre4. David O. Selznick entra en concurrence avec la MGM et la RKO pour s’attacher les services du metteur en scène. Malgré la flatteuse publicité dont Hitchcock jouissait aux États-Unis, l’obtention d’un engagement dans un grand studio n’allait pas de soi. Nul ne savait si le cinéaste anglais serait capable de satisfaire aux exigences commerciales. Surtout, nul ne savait si Hitchcock serait capable de soutenir l’important rythme imposé par le système de production5. Entre 1929 et 1937, il n’avait pas réalisé plus d’un film par an. Ses œuvres, à l’exception des films policiers, n’avaient connu qu’un succès modéré. Parmi les studios intéressés par Hitchcock, Selznick était sans doute le seul à pouvoir proposer au réalisateur un cadre artistique favorable à son épanouissement, tout en satisfaisant les exigences matérielles d’Hitchcock qui, pour le moins, confinaient à la gourmandise. Il convient aussi de souligner l’importance du rôle joué par le frère de David O. Selznick, Myron,
3. Rudy Behlmer, David O. Selznick. Cinéma [Memo from David O. Selznick, 1972], traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Villelaur, Paris, Ramsay, 1984, p. 13. 4. Ronald Haver, David O. Selznick’s Hollywood, Londres, Secker and Warburg, 1980, p. 313. 5. Leonard J. Leff, Hitchcock & Selznick : la riche et étrange collaboration entre Alfred Hitchcock et David O. Selznick à Hollywood, [1987], traduit de l’anglais (États-Unis) par Georges Goldfayn, Paris, Ramsay, 1990, p. 26.
13
APRÈS AVOIR IMPOSÉ UNE SUÉDOISE DANS INTERMEZZO [INGRID BERGMAN], UNE ANGLAISE DANS AUTANT EN EMPORTE LE VENT [VIVIEN LEIGH], SELZNICK DÉCIDE D’EMPLOYER DANS REBECCA CELLE QUE TOUT LE MONDE APPELLE « LA FEMME DE BOIS » : JOAN FONTAINE. LE GRAND HITCH EN FERA BIEN QUELQUE CHOSE, À CONDITION QU’IL NE PRÉNOMME PAS L’HÉROÏNE DAPHNÉ EN HOMMAGE À DU MAURIER, AUTEUR DU BEST-SELLER.
SELZNICK, LE PRODUCTEUR DONNE LA NOTE
(…) Bien que Rebecca n’ait pas déclenché dans le public un enthousiasme aussi considérable qu’Autant en emporte le vent, ce fut pour moi une expérience presque aussi passionnante. Durant un an, j’avais discuté avec Joan Fontaine et je lui avais fait faire des essais. Au cours de ces tractations, j’ai proposé à Sam Goldwyn et au producteur Hal Roach de signer avec elle un contrat à trois, mais ils visionnèrent ses autres films et ne voulurent pas d’elle. RKO lui donna deux jolies chances puis la laissa partir. À Hollywood, certaines personnes pensaient qu’elle avait si peu de talent qu’elles l’appelaient « la femme de bois ». Personne à notre place ne lui aurait proposé un centime pour jouer le rôle, et on ne comprenait pas pourquoi je m’obstinais à refuser les grandes stars qui brûlaient du désir de l’interpréter. (…) À un certain moment, je finis par fléchir, me disant que je ne pouvais pas être la seule personne lucide au monde, et j’acceptai qu’on renonce à l’option que j’avais prise sur Melle Fontaine. Puis, une semaine avant le début du tournage, je me rebiffai de nouveau. J’arpentai ma chambre toute une nuit en ruminant l’idée que, si on choisissait mal la vedette de Rebecca, le film serait mauvais. Et, puisque j’avais eu le culot d’engager une Anglaise pour interpréter Scarlett O’Hara, pourquoi n’aurais-je pas le courage de mes propres opinions à propos de Fontaine ? Je me dis qu’elle allait bénéficier de la direction du grand réalisateur que j’avais engagé pour le film, Alfred Hitchcock. Et j’arrivai au studio, plein d’allant, tôt le lendemain matin, décidé à l’engager.
30
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
31
À M. Alfred Hitchcock 12 juin 1939 Cher Hitch, Il me revient la tâche fâcheuse et désagréable de vous dire que j’ai été choqué et déçu au-delà de toute expression par l’adaptation de Rebecca1. Je la considère comme une version déformée et vulgarisée d’une œuvre qui s’est révélée un succès, et dans laquelle, pour des raisons qui m’échappent, des séquences parfaitement surannées ont été substituées aux scènes de Daphné du Maurier au charme captivant. C’est particulièrement vrai pour la séquence de la Riviera. (…) À mon avis, la différence des moyens d’expression ne justifie qu’une seule chose : que chaque scène soit racontée différemment. Et les seules coupures que l’on peut pratiquer dans un ouvrage à succès ne doivent leur justification qu’à des problèmes de longueur, de censure, ou d’autres considérations pratiques. Les lecteurs d’un livre qu’ils aiment beaucoup pardonneront les coupures si elles répondent à des raisons évidentes ; mais, à très juste titre, ils ne trouveront aucune excuse à des substitutions. Je ne suis pas non plus partisan de la théorie selon laquelle, pour faire un film, il faut changer les histoires parce qu’elles appartiennent à un genre dit « narratif ». J’ai adapté avec succès, et fidèlement, trop de classiques, pour ne pas savoir, sans l’ombre d’un doute, qu’un film, qu’il soit narratif ou dramatique, rencontrera autant de succès que l’original si l’on se soucie de conserver les éléments essentiels de l’original – y compris les prétendus « défauts » de construction dramatique. Personne, pas même l’auteur de l’œuvre originale, ne peut dire avec certitude pourquoi un livre a eu la chance de plaire au public. Si c’était facile, l’auteur n’aurait qu’à reprendre les mêmes éléments et retrouver le même succès, ce dont, nous le savons, très peu d’auteurs à succès ont été capables. (…) C’est pourquoi je n’ai cessé de vous prier d’être fidèle. J’ai moi aussi ma vanité d’auteur et il ne me déplaît pas de lâcher la bride à mes instincts créateurs sur un scénario original, comme ce fut le cas dans Une étoile est née, ou en adaptant une œuvre littéraire, comme dans Le Lien sacré. Mais mon ego n’a pas tant d’importance que je ne puisse le réprimer en adaptant un ouvrage à succès. Je ne crois pas pouvoir créer, en deux mois ou en deux ans, quoi que ce soit qui rivalise avec les personnages et les situations de Rebecca, tels que du Maurier les a créés. Et franchement, je ne crois pas que vous en soyez capable non plus. Je veux que cette compagnie produise Rebecca, et non un scénario original tiré de Rebecca. 1. Écrite par Philip MacDonald et Joan Harrison sous la direction d’Hitchcock.
32
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
J’espère que vous n’avez pas l’intention de donner à la fille le nom de Daphné ou tout autre nom. Immédiatement après le fait que le personnage qui donne son titre au livre n’apparaît jamais, ce qui a le plus frappé les lecteurs est que le personnage principal n’a pas de nom. Welles en a astucieusement tiré profit, et les dix ou quinze millions d’auditeurs qui ont été fascinés par l’histoire savent aussi que le personnage principal n’est jamais nommé. Nous serions tout à fait stupides de lui donner un nom dans notre film. Il n’est pas question ici de l’art de raconter une histoire, mais simplement de l’art du spectacle. (…) Il serait trop long d’entrer dans les détails de la rancœur qu’ont fait naître en moi les autres changements. De toute évidence, il y a des répétitions dans le livre, et il faudra réunir plusieurs scènes pour en faire une seule. Mais ce n’est pas une excuse pour transformer la sœur de Max en une autre Mme Van Hopper ; pour rejeter les portraits merveilleusement dessinés et très intéressants de sa sœur et de son beau-frère ; pour faire une comédie burlesque de ses exploits sur un terrain de golf, au lieu d’exprimer l’atmosphère de la promenade dans la propriété, avec une petite discussion très humaine à propos du chien qui court sur les rochers, et l’étrange comportement de Max qui en découle. La façon dont les lecteurs du livre sont peu à peu intrigués par la conduite mystérieuse de Mme Danvers, et les curieuses réactions de Max à certains détails, tout cela a été peu ou prou déformé, et il faudrait des jours et des jours pour les passer au peigne fin et voir, point par point, ce qu’on a perdu, exactement comme dans la séquence sur la Riviera. Je dois dire carrément que je trouve l’adaptation très mauvaise, et qu’il est plus facile d’en faire une autre que de raccommoder celle-ci. (…) Je ne comprends pas (…) pourquoi vous avez tenu à mettre la grandmère dans la tour de Manderley. Sans chercher d’autres raisons, le fait qu’elle ait sa propre maison permet de briser la monotonie née de sa présence continuelle dans les décors de Manderley. Cependant, il est possible que ce ne soit pas très important car il y a beaucoup de décors à l’intérieur de Manderley, son domaine, etc. et qu’il soit, au contraire, intéressant de ne pas en sortir. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que la grand-mère serve à grand-chose, et peut-être devrait-on la supprimer2. Il manque aussi d’autres petites choses, comme les nombreuses comparaisons entre Rebecca et la jeune fille qui amène celle-ci à avoir conscience de sa propre gaucherie – par exemple, quand elle compare son écriture à celle de Rebecca. (…) Je ne sais pas pourquoi vous avez transformé l’abri à bateaux en un petit cottage de pierre. C’est, à mes yeux, un changement gratuit qui ne semble 2. On l’a effectivement supprimée.
33
DÉPART VERS L’AMÉRIQUE Jonas Rosales. Comment situez-vous Rebecca dans la carrière d’Hitchcock ? Il s’agit d’une œuvre charnière dans sa filmographie.
LA PROJECTION PERMANENTE À PROPOS DE REBECCA Jean Douchet
Jean Douchet. À l’époque, il n’y avait pas tellement de grands cinéastes anglais, seulement deux ou trois. C’est surtout Hitchcock qui, de 1930 à 1940, tient la première place. Mais il reste un cinéaste anglais et il en souffre parce qu’il sait qu’il est meilleur que ça. On sait qu’au fond il désirait aller aux États-Unis mais être appelé par les États-Unis et non pas avoir à demander. Il voulait être quelqu’un qu’on appelle. Et c’est justement ce qui s’est passé : c’est Selznick qui l’a appelé. Son problème, c’était de faire son entrée à Hollywood. Comme il savait qu’il n’était pas américain, qu’il n’était pas encore capable de faire du cinéma purement « américain », il fallait qu’il entre en tant que cinéaste anglais avec un film qui soit très british. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quel point Hitchcock a joué sur ce côté british en arrivant en Amérique, alors que lorsqu’il était en Angleterre, il était « anti-anglais ». Ce qu’il aimait alors, c’était montrer la vulgarité anglaise – et il le prouvera de façon évidente quand il retournera tourner à Londres son avant-dernier film, Frenzy, où la vulgarité anglaise réapparaîtra de façon très forte. Alors que, à son arrivée aux États-Unis, il joue sur son côté très british, très dandy. Et il va transformer cette idée du dandysme en faisant de tous ses assassins des dandys, des snobs. C’est ainsi qu’Hitchcock acquiert une certaine réputation à Hollywood, celle du cinéaste anglais par excellence. Mais en même temps, il est intéressant de voir que cette idée de l’Angleterre lui déplaît profondément. Et cela est visible dès Rebecca. Le véritable sujet de ce film, c’est une femme de la classe très moyenne qui entre dans le très grand monde. Elle est en état d’infériorité, de peur, et elle va finalement accéder à cette classe non pas en se pliant à son nouveau milieu mais en étant elle-même. C’est ce jeu-là que joue Hitchcock.
LE PERSONNAGE DE REBECCA J. Douchet. On observe dans le film une double représentation de l’Autre Femme incarnée par Rebecca – soit la British totale – par des femmes qui n’appartiennent pas au monde de l’aristocratie. La première, c’est Mme Van Hopper, celle qui joue à la snob mais qui n’en est pas une, à son grand regret. Sa projection, toute en vulgarité et en grossièreté, fait face à celle de Mme Danvers,
68
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
69
DÉPART VERS L’AMÉRIQUE Jonas Rosales. Comment situez-vous Rebecca dans la carrière d’Hitchcock ? Il s’agit d’une œuvre charnière dans sa filmographie.
LA PROJECTION PERMANENTE À PROPOS DE REBECCA Jean Douchet
Jean Douchet. À l’époque, il n’y avait pas tellement de grands cinéastes anglais, seulement deux ou trois. C’est surtout Hitchcock qui, de 1930 à 1940, tient la première place. Mais il reste un cinéaste anglais et il en souffre parce qu’il sait qu’il est meilleur que ça. On sait qu’au fond il désirait aller aux États-Unis mais être appelé par les États-Unis et non pas avoir à demander. Il voulait être quelqu’un qu’on appelle. Et c’est justement ce qui s’est passé : c’est Selznick qui l’a appelé. Son problème, c’était de faire son entrée à Hollywood. Comme il savait qu’il n’était pas américain, qu’il n’était pas encore capable de faire du cinéma purement « américain », il fallait qu’il entre en tant que cinéaste anglais avec un film qui soit très british. Il est d’ailleurs intéressant de constater à quel point Hitchcock a joué sur ce côté british en arrivant en Amérique, alors que lorsqu’il était en Angleterre, il était « anti-anglais ». Ce qu’il aimait alors, c’était montrer la vulgarité anglaise – et il le prouvera de façon évidente quand il retournera tourner à Londres son avant-dernier film, Frenzy, où la vulgarité anglaise réapparaîtra de façon très forte. Alors que, à son arrivée aux États-Unis, il joue sur son côté très british, très dandy. Et il va transformer cette idée du dandysme en faisant de tous ses assassins des dandys, des snobs. C’est ainsi qu’Hitchcock acquiert une certaine réputation à Hollywood, celle du cinéaste anglais par excellence. Mais en même temps, il est intéressant de voir que cette idée de l’Angleterre lui déplaît profondément. Et cela est visible dès Rebecca. Le véritable sujet de ce film, c’est une femme de la classe très moyenne qui entre dans le très grand monde. Elle est en état d’infériorité, de peur, et elle va finalement accéder à cette classe non pas en se pliant à son nouveau milieu mais en étant elle-même. C’est ce jeu-là que joue Hitchcock.
LE PERSONNAGE DE REBECCA J. Douchet. On observe dans le film une double représentation de l’Autre Femme incarnée par Rebecca – soit la British totale – par des femmes qui n’appartiennent pas au monde de l’aristocratie. La première, c’est Mme Van Hopper, celle qui joue à la snob mais qui n’en est pas une, à son grand regret. Sa projection, toute en vulgarité et en grossièreté, fait face à celle de Mme Danvers,
68
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
69
qui elle est une admiratrice totale de l’aristocratie, qui ne voit que sa perfection absolue incarnée par Rebecca. Ce personnage devient obsessionnel et gagne en intérêt puisqu’Hitchcock va le transformer en une sorte de démon, de fantôme. Tout l’enjeu va être de transcrire cela par l’écriture cinématographique, à travers les jeux d’ombre et de lumière – une relecture de l’expressionnisme « à la sauce anglaise ». Dès le générique nous sont donnés les ingrédients qui vont composer le film : l’ombre et la lumière, le noir et le blanc, les nuages, les brumes… Avec, comme toujours chez Hitchcock, l’idée que le bien n’est pas forcément incarné par le blanc, et inversement. On le voit très clairement lorsque notre héroïne – qui n’a ni nom ni prénom, qui n’est rien – va s’habiller pour le bal et qu’elle met la robe de Rebecca, entièrement blanche. Mme Danvers, toute de noir vêtue, lui dit de mettre cette robe blanche, sachant que cela aboutira à sa destruction. Qu’elle ne pourra en aucun cas être rivale de Rebecca. Mais en même temps, Rebecca est une femme profondément méchante, froide, qui n’a aucune humanité. Elle est en quelque sorte l’incarnation du Mal. J. Rosales. Rebecca est un personnage qui n’existe pas physiquement dans le film, c’est un esprit. Pourrait-on parler de « film de fantôme » ? J. Douchet. Ce ne sont pas des fantômes chez Hitchcock mais des existences mentales. Rebecca a bien existé, mais cette existence n’a aucun intérêt si ce n’est qu’elle a été la lady parfaite. Une femme odieuse qu’on déteste, mais qu’en même temps tout le monde aime parce que c’est quand même une grande lady. En revanche, ce personnage qui a existé mais qui n’existe plus, ce n’est pas son fantôme qui est là. C’est l’idée même d’une classe sociale dans sa représentation qui va provoquer un complexe d’infériorité chez l’héroïne.
L’ADAPTATION DU ROMAN J. Rosales. Le film est construit en trois parties, avec le préambule du rêve. La première, qui dure près d’une demi-heure, se situe à Monte-Carlo et ressemble à une comédie de Lubitsch. La deuxième, la plus longue, constitue le cœur du film : on y découvre Manderley et ses habitants. Enfin, il y a le dénouement policier avec la découverte du deuxième corps. J. Douchet. Et là, dans la troisième partie, on se rend compte qu’il n’est pas encore le Hitchcock qu’il va devenir. Ce développement est scénaristique. Bien sûr qu’il est mis en scène et plutôt bien fait, mais c’est une mise en scène
70
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
explicative et non créatrice. Et on résout le problème policier. Heureusement que le film se termine par l’incendie et par l’admirable plan de Mme Danvers dans les flammes. J. Rosales. On sait toutefois que le rapport de forces avec Selznick a été très difficile. Comme c’était un roman qui avait eu un immense succès à l’époque, il tenait à ce que les gens retrouvent l’histoire telle quelle. J. Douchet. Il voulait « l’adaptation ». J. Rosales. Le générique commence par ces mots : « Selznick International presents its picturization of Daphne du Maurier’s celebrated novel ». Le message est sans équivoque : « Selznick vous présente la mise en images du célèbre roman de Daphné du Maurier ». J. Douchet. C’est-à-dire une adaptation exacte. Mais il existe en parallèle une critique sous-jacente de l’aristocratie anglaise. Hitchcock condamne ce monde de la gentry qui est selon lui un monde inhumain, inacceptable, qui fait de l’Angleterre – du moins à cette époque-là – un pays invivable au quotidien. J. Rosales. Daphné du Maurier appréciait beaucoup Rebecca mais n’aimait pas du tout l’adaptation d’Hitchcock de sa nouvelle Les Oiseaux. J. Douchet. Parce qu’avec Rebecca, elle avait l’impression qu’on avait respecté son œuvre. Or lorsqu’Hitchcock va adapter Les Oiseaux, il ne restait plus rien de la nouvelle de Daphné du Maurier. J. Rosales. Le cinéaste a également pris beaucoup de libertés dans La Taverne de la Jamaïque, son dernier film anglais avant son départ à Hollywood. Car Hitchcock a enchaîné deux adaptations de Daphné du Maurier. J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’Hitchcock courait après le succès, or Daphné du Maurier était reconnue comme une auteure à succès. J. Rosales. Dans ses entretiens avec Hitchcock, Truffaut lui dit qu’il considère Rebecca comme un sujet qui lui est lointain. Ce qui est intéressant, c’est qu’Hitchcock lui répond qu’il avait déjà eu l’idée d’adapter le roman en Angleterre mais qu’il n’avait pas eu les droits en raison du surcoût du projet. Il s’agit d’une coïncidence assez surprenante…
71
qui elle est une admiratrice totale de l’aristocratie, qui ne voit que sa perfection absolue incarnée par Rebecca. Ce personnage devient obsessionnel et gagne en intérêt puisqu’Hitchcock va le transformer en une sorte de démon, de fantôme. Tout l’enjeu va être de transcrire cela par l’écriture cinématographique, à travers les jeux d’ombre et de lumière – une relecture de l’expressionnisme « à la sauce anglaise ». Dès le générique nous sont donnés les ingrédients qui vont composer le film : l’ombre et la lumière, le noir et le blanc, les nuages, les brumes… Avec, comme toujours chez Hitchcock, l’idée que le bien n’est pas forcément incarné par le blanc, et inversement. On le voit très clairement lorsque notre héroïne – qui n’a ni nom ni prénom, qui n’est rien – va s’habiller pour le bal et qu’elle met la robe de Rebecca, entièrement blanche. Mme Danvers, toute de noir vêtue, lui dit de mettre cette robe blanche, sachant que cela aboutira à sa destruction. Qu’elle ne pourra en aucun cas être rivale de Rebecca. Mais en même temps, Rebecca est une femme profondément méchante, froide, qui n’a aucune humanité. Elle est en quelque sorte l’incarnation du Mal. J. Rosales. Rebecca est un personnage qui n’existe pas physiquement dans le film, c’est un esprit. Pourrait-on parler de « film de fantôme » ? J. Douchet. Ce ne sont pas des fantômes chez Hitchcock mais des existences mentales. Rebecca a bien existé, mais cette existence n’a aucun intérêt si ce n’est qu’elle a été la lady parfaite. Une femme odieuse qu’on déteste, mais qu’en même temps tout le monde aime parce que c’est quand même une grande lady. En revanche, ce personnage qui a existé mais qui n’existe plus, ce n’est pas son fantôme qui est là. C’est l’idée même d’une classe sociale dans sa représentation qui va provoquer un complexe d’infériorité chez l’héroïne.
L’ADAPTATION DU ROMAN J. Rosales. Le film est construit en trois parties, avec le préambule du rêve. La première, qui dure près d’une demi-heure, se situe à Monte-Carlo et ressemble à une comédie de Lubitsch. La deuxième, la plus longue, constitue le cœur du film : on y découvre Manderley et ses habitants. Enfin, il y a le dénouement policier avec la découverte du deuxième corps. J. Douchet. Et là, dans la troisième partie, on se rend compte qu’il n’est pas encore le Hitchcock qu’il va devenir. Ce développement est scénaristique. Bien sûr qu’il est mis en scène et plutôt bien fait, mais c’est une mise en scène
70
explicative et non créatrice. Et on résout le problème policier. Heureusement que le film se termine par l’incendie et par l’admirable plan de Mme Danvers dans les flammes. J. Rosales. On sait toutefois que le rapport de forces avec Selznick a été très difficile. Comme c’était un roman qui avait eu un immense succès à l’époque, il tenait à ce que les gens retrouvent l’histoire telle quelle. J. Douchet. Il voulait « l’adaptation ». J. Rosales. Le générique commence par ces mots : « Selznick International presents its picturization of Daphne du Maurier’s celebrated novel ». Le message est sans équivoque : « Selznick vous présente la mise en images du célèbre roman de Daphné du Maurier ». J. Douchet. C’est-à-dire une adaptation exacte. Mais il existe en parallèle une critique sous-jacente de l’aristocratie anglaise. Hitchcock condamne ce monde de la gentry qui est selon lui un monde inhumain, inacceptable, qui fait de l’Angleterre – du moins à cette époque-là – un pays invivable au quotidien. J. Rosales. Daphné du Maurier appréciait beaucoup Rebecca mais n’aimait pas du tout l’adaptation d’Hitchcock de sa nouvelle Les Oiseaux. J. Douchet. Parce qu’avec Rebecca, elle avait l’impression qu’on avait respecté son œuvre. Or lorsqu’Hitchcock va adapter Les Oiseaux, il ne restait plus rien de la nouvelle de Daphné du Maurier. J. Rosales. Le cinéaste a également pris beaucoup de libertés dans La Taverne de la Jamaïque, son dernier film anglais avant son départ à Hollywood. Car Hitchcock a enchaîné deux adaptations de Daphné du Maurier. J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’Hitchcock courait après le succès, or Daphné du Maurier était reconnue comme une auteure à succès. J. Rosales. Dans ses entretiens avec Hitchcock, Truffaut lui dit qu’il considère Rebecca comme un sujet qui lui est lointain. Ce qui est intéressant, c’est qu’Hitchcock lui répond qu’il avait déjà eu l’idée d’adapter le roman en Angleterre mais qu’il n’avait pas eu les droits en raison du surcoût du projet. Il s’agit d’une coïncidence assez surprenante…
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
71
J. Douchet. Il ne faut pas oublier qu’il y a chez Hitchcock un côté irlandais, catholique. En effet, il y a chez lui une réserve sur cette société anglaise protestante et son hypocrisie profonde. Ce qui agace fondamentalement Hitchcock, c’est cette hypocrisie. Il voulait la démontrer. S’il avait tourné en Angleterre, je crois qu’il n’aurait pas eu la liberté d’être aussi violent que dans ce film. Il démolit totalement l’intrigue. Tout à l’heure, je parlais du générique en tant que tel : les ombres, les lumières, la forêt, le chemin… Comment ce grand chemin qui menait au château est devenu un petit chemin de rien du tout. Hitchcock organise la destruction de cet univers fictif. Ensuite il y a la scène de la rencontre au sommet de la falaise. Le personnage de Maxim rejette tout de suite l’héroïne, avec une violence extrême. En d’autres termes : « Je ne veux pas de femme, foutez-moi le camp ! ». Immédiatement après, il lui fait la cour. D’un point de vue scénaristique, c’est un peu curieux. Mais en même temps, cela montre que le personnage de Maxim est avant tout un aristocrate. D’emblée, il la traite avec mépris… en tant qu’aristocrate ! C’est lui qui domine – qu’il veuille se jeter de la falaise est présupposé. Il y a aussi une image récurrente dans le film : celle de la mer qui avance avec fureur. Comme si, face à la vie réelle, il y avait cette volonté de refuser cette vie pour imposer son soi. C’est ça qui est frappant, alors que cette héroïne n’a rien à faire dans ce monde. Elle intéresse Maxim parce qu’elle est celle qui n’est pas de ce monde et qu’il peut l’amener dans son monde. Surtout, il ne veut pas la reconnaître en Rebecca. Elle ne peut pas être Rebecca ! J. Rosales. Il y a quelques petits détails qui ne figurent pas dans le livre. Je pense à deux séquences en particulier qui ne sont pas dans le roman mais sont pourtant assez significatives. La première, c’est l’histoire que raconte l’héroïne au restaurant lorsqu’elle parle de son père et dit qu’il peignait toujours le même arbre. J. Douchet. C’est une confession d’Hitchcock. Il n’a toujours peint qu’une seule chose : l’état de dépendance d’un imaginaire par rapport au réel. Comment l’imaginaire veut transformer le réel. Le propre même du cinéma. Il le traite d’une façon maladive, perverse. J. Rosales. Ce dialogue n’apporte rien à l’intrigue. J. Douchet. En revanche, il dit. C’est une déclaration d’auteur. J. Rosales. L’autre scène qui n’est pas dans le roman, c’est le passage où Maxim
72
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
projette les films de leur voyage de noces, les home movies. J. Douchet. Et d’un seul coup, enfin, il met le cinéma en dominante et non plus en second. Ce qu’il va malheureusement faire dans la fin du film où le cinéma ne fait que suivre le scénario. Alors que là, d’un seul coup, le cinéma prend place et entre dans l’espace. Les personnages sont dans le cinéma, et non plus à l’extérieur. J. Rosales. C’est une séquence extrêmement sophistiquée du point de vue de la mise en scène. J. Douchet. Forcément puisque là, il reconstruit le cinéma et que le cinéma envahit l’espace réel. On est dans le mouvement de l’imaginaire donc dans ce moment où le spectateur projette. On est dans la projection du spectateur, sauf que les personnages sont dans la projection.
UN FILM AU FÉMININ J. Rosales. Rebecca est un film qui épouse le point de vue d’une femme. J. Douchet. Qui épouse le point de vue des femmes. La première, c’est la bourgeoise enrichie, la « moi, j’ai » – « Moi j’ai et tout le monde m’obéit parce que j’ai. » Elle possède une vision du monde terriblement marchande car, au fond, Mme Van Hopper est une commerçante. C’est une féminité qui a perdu toute féminité. Ce personnage va avoir sa projection, son double, en Mme Danvers. Les deux femmes sont dans l’admiration, mais cela se joue de façon beaucoup plus complexe chez la gouvernante. Car celle-ci admire en même temps qu’elle aime. Or si elle aime, elle désire. Il existe, comme souvent chez Hitchcock, un soupçon d’homosexualité. Il est évident que Mme Danvers était folle d’amour pour Rebecca. Donc l’autre femme, l’héroïne, ne peut être que rien. Rebecca était la femme sociabilisée et en même temps totalement idéalisée, la femme parfaite. Celle que l’on désire. De ce point de vue, ça devient une rivalité amoureuse. Mais elle est une amoureuse très étrange, très hitchcockienne : une femme amoureuse d’une femme face à une autre femme amoureuse d’un homme. Et l’homme que l’on croit avoir été amoureux de la femme divinisée est en réalité amoureux de la femme faible parce que, à ce moment-là, il a face à lui quelqu’un de faible, comme lui, qu’il peut aimer. Mais il y a aussi un autre personnage féminin très intéressant dans le film, c’est celui de la sœur. Elle est plus sympathique, ce qui
73
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
David O. Selznick et Alfred Hitchcock.
42
43
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
92
93
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
104
105
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
162
163
HITCHCOCK BOGDANOVICH DIVERS CHABROL LEXIQUE
258 266
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
259 267
Vous ne regardez jamais vos films avec un public. Cela ne vous manque pas d’entendre les spectateurs crier ? Non. Je les entends crier quand je tourne mes films. – Alfred Hitchcock
HITCHCOCK/BOGDANOVICH ENTRETIEN
Dans l’histoire du cinéma, Alfred Hitchcock occupe une position unique : c’est le seul réalisateur (à la possible exception de Cecil B. DeMille) dont le nom fait apparaître une image spécifique dans l’esprit du spectateur moyen (là aussi, si l’on excepte des acteurs-réalisateurs tels que Chaplin, dont la popularité repose sur leur performance en tant que comédien plutôt que sur leur œuvre derrière la caméra). C’est le seul réalisateur actuel dont les films sont vendus sur son seul nom, un nom devenu synonyme, dans l’inconscient collectif, d’un certain type de film. On parle de film hitchcockien plus que d’un film d’Hitchcock. Le genre dans lequel il œuvre, au sens large (thrillers, films policiers, comédies macabres, films à suspense) est considéré par les critiques américains comme peu respectable et dénué de valeur artistique. En Angleterre, ce type de film est sophistiqué et respecté. En fait, comme il le reconnaît lui-même, Hitchcock a une personnalité mêlant nettement l’humour britannique et le dynamisme américain. Dans le cinéma anglais, il est le seul réalisateur digne d’intérêt, l’unique contribution de ce pays au septième art. Cependant, cela fait 23 ans qu’il travaille aux États-Unis. Plus de la moitié de sa carrière s’est déroulée dans ce pays. De plus, comme il aime à le rappeler, il a forgé son expérience et appris les rudiments de son métier grâce aux Américains. Par conséquent, on ne peut plus le qualifier de réalisateur britannique, si tant est qu’on ait pu le faire un jour. Selon tous les critères (sauf son ironie et son étrange sens de l’humour), c’est un artiste américain, à l’instar de Chaplin, en dépit de son lieu de naissance. Avez-vous le sentiment que le cinéma américain est toujours le plus important de tous ? À l’échelle de la planète, oui1. En effet, quand nous faisons des films pour les ÉtatsUnis, nous les faisons automatiquement pour le monde entier, parce que ce pays est rempli d’étrangers. C’est un melting pot. Cela m’amène à aborder un autre point. Je ne sais pas ce qu’on désigne par l’expression « films hollywoodiens ». Je réponds à cela par une question : « Où sont-ils donc conçus ? » Regardez cette pièce : on ne peut pas regarder par les fenêtres. Nous pourrions tout aussi bien être dans une chambre d’hôtel à Londres, ou n’importe où ailleurs. Voilà l’endroit où l’on écrit les scénarios. Et ensuite, où allons-nous ? Tourner en décors réels, soit, mais sinon, où travaillons-nous ? Sur un plateau de tournage, fermé par de grandes portes.
260
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
1. Toutes les remarques et les réponses de M. Hitchcock sont tirées d’une longue interview qu’il m’a accordée, enregistrée au magnétophone les 12, 13 et 14 février à ses bureaux des studios Universal, à Hollywood.
261
Vous ne regardez jamais vos films avec un public. Cela ne vous manque pas d’entendre les spectateurs crier ? Non. Je les entends crier quand je tourne mes films. – Alfred Hitchcock
HITCHCOCK/BOGDANOVICH ENTRETIEN
Dans l’histoire du cinéma, Alfred Hitchcock occupe une position unique : c’est le seul réalisateur (à la possible exception de Cecil B. DeMille) dont le nom fait apparaître une image spécifique dans l’esprit du spectateur moyen (là aussi, si l’on excepte des acteurs-réalisateurs tels que Chaplin, dont la popularité repose sur leur performance en tant que comédien plutôt que sur leur œuvre derrière la caméra). C’est le seul réalisateur actuel dont les films sont vendus sur son seul nom, un nom devenu synonyme, dans l’inconscient collectif, d’un certain type de film. On parle de film hitchcockien plus que d’un film d’Hitchcock. Le genre dans lequel il œuvre, au sens large (thrillers, films policiers, comédies macabres, films à suspense) est considéré par les critiques américains comme peu respectable et dénué de valeur artistique. En Angleterre, ce type de film est sophistiqué et respecté. En fait, comme il le reconnaît lui-même, Hitchcock a une personnalité mêlant nettement l’humour britannique et le dynamisme américain. Dans le cinéma anglais, il est le seul réalisateur digne d’intérêt, l’unique contribution de ce pays au septième art. Cependant, cela fait 23 ans qu’il travaille aux États-Unis. Plus de la moitié de sa carrière s’est déroulée dans ce pays. De plus, comme il aime à le rappeler, il a forgé son expérience et appris les rudiments de son métier grâce aux Américains. Par conséquent, on ne peut plus le qualifier de réalisateur britannique, si tant est qu’on ait pu le faire un jour. Selon tous les critères (sauf son ironie et son étrange sens de l’humour), c’est un artiste américain, à l’instar de Chaplin, en dépit de son lieu de naissance. Avez-vous le sentiment que le cinéma américain est toujours le plus important de tous ? À l’échelle de la planète, oui1. En effet, quand nous faisons des films pour les ÉtatsUnis, nous les faisons automatiquement pour le monde entier, parce que ce pays est rempli d’étrangers. C’est un melting pot. Cela m’amène à aborder un autre point. Je ne sais pas ce qu’on désigne par l’expression « films hollywoodiens ». Je réponds à cela par une question : « Où sont-ils donc conçus ? » Regardez cette pièce : on ne peut pas regarder par les fenêtres. Nous pourrions tout aussi bien être dans une chambre d’hôtel à Londres, ou n’importe où ailleurs. Voilà l’endroit où l’on écrit les scénarios. Et ensuite, où allons-nous ? Tourner en décors réels, soit, mais sinon, où travaillons-nous ? Sur un plateau de tournage, fermé par de grandes portes. 1. Toutes les remarques et les réponses de M. Hitchcock sont tirées d’une longue interview qu’il m’a accordée, enregistrée au magnétophone les 12, 13 et 14 février à ses bureaux des studios Universal, à Hollywood. REPRODUCTION INTERDITE
260
PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
261
C’est comme une mine de charbon : nous ne savons même pas quel temps il fait dehors. Je le répète, nous ne savons pas où nous sommes. Nous sommes uniquement à l’intérieur du film, de cette chose que nous fabriquons. C’est pour cela qu’il est absurde de raisonner en termes géographiques. « Hollywood »… Cela ne signifie rien pour moi. Quand on me demande pourquoi j’aime travailler à Hollywood, je réponds : « Parce que je peux rentrer chez moi à 18 h, pour le dîner. » Les critiques de cinéma ont tendance à dire que son « âge d’or » correspond aux films de sa période anglaise allant du premier Homme qui en savait trop (1934) à Une femme disparaît (1938), c’est-à-dire juste avant son arrivée aux États-Unis. C’est sans doute en Angleterre que cette opinion vit le jour, puisqu’avec les six films qu’il réalisa au cours de ces quatre années, ainsi que The Lodger (1926) et Chantage (1929), on tient là de toute évidence les huit meilleurs films jamais faits dans ce pays : leur dynamisme, leur inventivité, leur forte personnalité et leurs qualités cinématographiques n’ont jamais été égalés par un réalisateur anglais, avant ou après. En un sens, c’est par autodéfense que les Anglais déclarèrent qu’Hitchcock avait cédé aux sirènes des États-Unis, s’était coupé de ses racines et avait gâché son talent. Au bout de quelques années, une fois que le motif peu avouable de cette accusation fut tombé dans l’oubli, les snobs américains reprirent cette séduisante théorie du « déclin d’Hitchcock » et se l’approprièrent. Parallèlement, la popularité d’Hitchcock n’a cessé de croître. C’est l’une de ces heureuses situations où le public a eu entièrement raison. En vérité, les films américains d’Hitchcock n’ont pas seulement touché un public plus large, mais ils sont aussi beaucoup plus personnels et aboutis, plus contrôlés et originaux, plus ingénieux et sérieux que tout ce qu’il a pu faire pendant son « âge d’or ». La seule excuse pardonnable pour continuer à préférer sa production anglaise à ses films américains est la nostalgie, et encore. Comment définiriez-vous le cinéma pur ? Le cinéma pur, c’est l’assemblage de morceaux de film complémentaires, tout comme une mélodie est constituée de notes de musique. Je distingue deux utilisations principales du montage : pour créer des idées et pour créer de la violence ou des émotions. Par exemple, à la fin de Fenêtre sur cour, lorsque James Stewart est jeté par la fenêtre, j’ai construit cette séquence avec des plans de pied, de jambe, de bras, de tête. C’est uniquement du montage. J’avais aussi filmé l’action entière de loin, mais cela n’avait rien à voir. Cela n’a jamais rien à voir. Prenez une bagarre de saloon, dans un western : un personnage met son adversaire hors combat, ou le propulse contre une table qui se brise sous l’impact,
262
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
comme de bien entendu. Eh bien, les séquences de ce genre sont systématiquement filmées de loin. Pourtant, elles sont plus efficaces si on les construit au montage, parce qu’on implique davantage le public. Voilà le secret de ce type de montage au cinéma. L’autre type de montage, évidemment, consiste à juxtaposer des images reliées à l’esprit d’un individu. On voit un homme regarder quelque chose, on voit ce qu’il regarde, puis on revient sur lui. On peut le faire réagir de différentes manières. On peut le montrer regarder une chose, puis une autre. Sans qu’il parle, on peut montrer son esprit fonctionner, comparer des choses. C’est la liberté absolue. Je dirais que le pouvoir du montage et de l’assemblage des images est infini. Par exemple, dans Les Oiseaux, lorsque la caméra se rapproche de l’homme énucléé, les sautes correspondent à une respiration saccadée. Est-ce bien cela ? Halètement… Halètement… Oui. Certains jeunes réalisateurs se disent : « On va transformer la caméra en personnage et la faire se déplacer comme un être humain, puis on va la placer devant un miroir pour qu’on voie de qui il s’agit. » C’est une énorme erreur. Robert Montgomery a fait ça dans La Dame du lac (1947), mais personnellement, je n’arrive pas à y croire. Que croit-on faire avec ça ? On cache aux spectateurs l’identité du personnage. Pourquoi ? C’est tout ce que ça produit. Pourquoi ne pas montrer de qui il s’agit ? Hitchcock a traversé plusieurs phases pendant sa période américaine, essayant sans cesse de nouveaux effets, relevant de nouveaux défis, approfondissant sa vision du monde. Dans Rebecca (1940), la caméra est plus fluide que dans ses films précédents ; le montage (la clé de son style) n’y est pas abandonné, mais le travelling est mis en avant, tout comme dans La Maison du docteur Edwardes (1945), Les Enchaînés (1946) et Le Procès Paradine (1947). Cette tendance culmine dans La Corde (1948), où il n’y a aucune coupe. On peut décrire le film comme un seul long plan, à cause du mouvement constant de la caméra. (En réalité, il y a huit plans de dix minutes, un par bobine de film.) L’utilisation la plus efficace de cette technique est peut-être dans Les Amants du Capricorne (1949), un virage dans sa carrière (un film d’époque qui n’est pas vraiment un thriller). Ce fut un échec commercial, sans doute parce qu’Hitchcock faisait là un film inattendu de sa part. (Depuis, il a déclaré qu’il n’aimait pas les « films en costume », parce qu’il « ne peut pas imaginer un personnage de films en costume allant aux toilettes ».) Quelle est votre méthode de tournage ? Eh bien, je ne regarde jamais dans l’objectif, vous savez. L’opérateur me connaît suffisamment pour savoir ce que je veux, et en cas de doute, je trace un rectangle et je lui dessine à quoi doit ressembler le plan. L’important, tout d’abord, c’est qu’on
263
LEXIQUE MYTHOLOGIQUE POUR L’ŒUVRE DE HITCHCOCK Philippe Demonsablon
Et d’abord, pourquoi ce lexique ? Que l’on le voie pas, dans le recensement ici entrepris, un dithyrambe de plus, avec un rien de pédant. Et pas davantage un exercice comparable à celui de ces Hindous dont on dit qu’ils prennent le nom de Dieu, car ils s’occupent à répéter sans cesse « Dieu, Dieu, Dieu ». Bref ce lexique prise assez peu les vertus de l’énumération et ne se connaît pas de dette envers l’idée de tout réduire en un classement. Ailleurs est son propos. La création chez Hitchcock reste suspendue entre le réalisme et l’abstraction ; elle tend à l’abstrait par l’attention inaccoutumée qu’elle porte au concret. Aux thèmes dramatiques qu’elle explicite, elle superpose certains éléments plastiques et, par leur biais, introduit à nouveau ces thèmes avec plus de généralité et plus de précision. De tels éléments ne sont plus des accessoires et ne sont pas des symboles, au sens qui voudrait les traduire mot à mot ; ce sont plutôt des images autour desquelles la création s’organise pour réaliser la synthèse expressive de certains thèmes. Ce lexique se propose d’aider à préciser ces images pour distinguer en elles la part de l’ornement et la part de mythologie.
BIJOUX
Leur beauté séduit et peut servir d’appât, car ils sont le plus souvent un piège. Mais ils fixent aussi quelque endroit par où saisir ceux qui les portent ; ce sont des anses, des poignées. Ils manifestent la dépendance.
ALLIANCE
THE RING : Scène du mariage : Carl Brisson passe l’alliance au doigt de Lillian Hall-Davis. REAR WINDOW : Grace Kelly porte au doigt l’alliance de la femme assassinée et la montre à distance à James Stewart.
BAGUE
SHADOW OF A DOUBT : 1° Joseph Cotten enfile l’émeraude volée au doigt de Teresa Wright. 2° Dans la scène du bar, Teresa Wright rend à Cotten l’émeraude qu’elle ne porte plus. 3° Après la seconde tentative de meurtre, Teresa Wright porte à nouveau la bague. Et aussi : la veuve joyeuse rencontrant Cotten à la banque le regarde en remuant du doigt sa bague.
BRACELET
THE RING : 1° Ian Hunter enfile le bracelet au bras de Lillian Hall-Davis ; tout au long du film elle le cache de sa main pour le découvrir à Ian Hunter. 2° Carl Brisson ôte le bracelet et l’enfile au doigt de Lillian Hall-Davis, comme une alliance.
278
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
Ce lexique a été publié dans les Cahiers du Cinéma en 1956 et traite des films jusqu’à cette date. Les titres des films, tous cités en anglais, ont été conservés.
279
LEXIQUE MYTHOLOGIQUE POUR L’ŒUVRE DE HITCHCOCK Philippe Demonsablon
Et d’abord, pourquoi ce lexique ? Que l’on le voie pas, dans le recensement ici entrepris, un dithyrambe de plus, avec un rien de pédant. Et pas davantage un exercice comparable à celui de ces Hindous dont on dit qu’ils prennent le nom de Dieu, car ils s’occupent à répéter sans cesse « Dieu, Dieu, Dieu ». Bref ce lexique prise assez peu les vertus de l’énumération et ne se connaît pas de dette envers l’idée de tout réduire en un classement. Ailleurs est son propos. La création chez Hitchcock reste suspendue entre le réalisme et l’abstraction ; elle tend à l’abstrait par l’attention inaccoutumée qu’elle porte au concret. Aux thèmes dramatiques qu’elle explicite, elle superpose certains éléments plastiques et, par leur biais, introduit à nouveau ces thèmes avec plus de généralité et plus de précision. De tels éléments ne sont plus des accessoires et ne sont pas des symboles, au sens qui voudrait les traduire mot à mot ; ce sont plutôt des images autour desquelles la création s’organise pour réaliser la synthèse expressive de certains thèmes. Ce lexique se propose d’aider à préciser ces images pour distinguer en elles la part de l’ornement et la part de mythologie.
BIJOUX
Leur beauté séduit et peut servir d’appât, car ils sont le plus souvent un piège. Mais ils fixent aussi quelque endroit par où saisir ceux qui les portent ; ce sont des anses, des poignées. Ils manifestent la dépendance.
ALLIANCE
THE RING : Scène du mariage : Carl Brisson passe l’alliance au doigt de Lillian Hall-Davis. REAR WINDOW : Grace Kelly porte au doigt l’alliance de la femme assassinée et la montre à distance à James Stewart.
BAGUE
SHADOW OF A DOUBT : 1° Joseph Cotten enfile l’émeraude volée au doigt de Teresa Wright. 2° Dans la scène du bar, Teresa Wright rend à Cotten l’émeraude qu’elle ne porte plus. 3° Après la seconde tentative de meurtre, Teresa Wright porte à nouveau la bague. Et aussi : la veuve joyeuse rencontrant Cotten à la banque le regarde en remuant du doigt sa bague.
BRACELET
THE RING : 1° Ian Hunter enfile le bracelet au bras de Lillian Hall-Davis ; tout au long du film elle le cache de sa main pour le découvrir à Ian Hunter. 2° Carl Brisson ôte le bracelet et l’enfile au doigt de Lillian Hall-Davis, comme une alliance.
Ce lexique a été publié dans les Cahiers du Cinéma en 1956 et traite des films jusqu’à cette date. Les titres des films, tous cités en anglais, ont été conservés.
278
REPRODUCTION INTERDITE PROPRIÉTÉ DE CARLOTTA FILMS
279