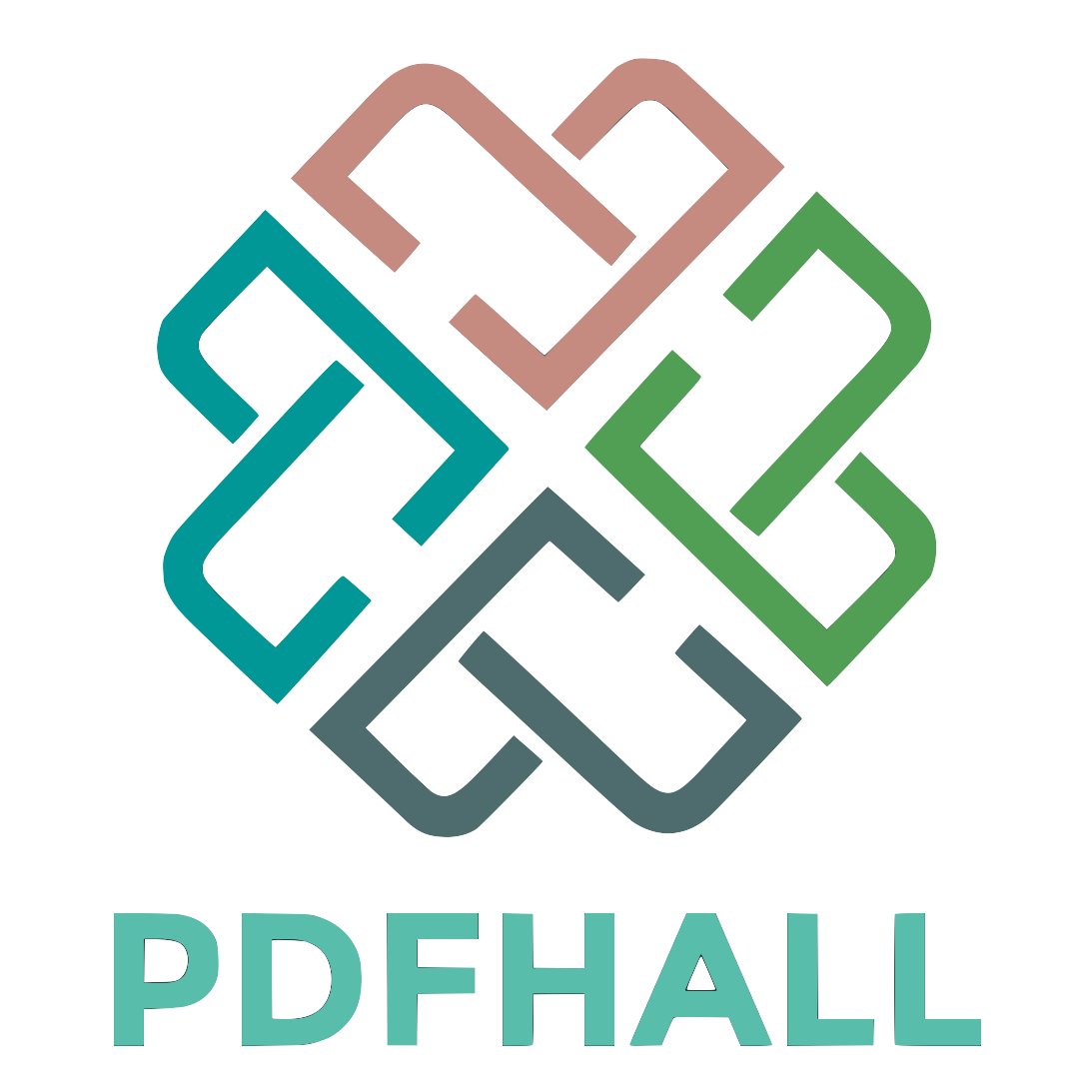Liste des résumés
Sophie Gilbert. COMPARAISON DE DEUX .... Racine2, Michel White2, Anique Ducharme2, Martin Sirois2, Anita Asgar2, Reda Ibrahim2,. Jean-François Dorval2 ...
Liste des résumés LA SIGNALISATION BMP9/ALK1 DANS LA PRÉVENTION DE LA PERMÉABILITÉ RÉTINIENNE HYPERGLYCÉMIQUE Naoufal Akla LE GDF-15 EST ASSOCIÉ À LA CAPACITÉ FONCTIONNELLE ET LA DYSFONCTION VENTRICULAIRE CHEZ LES PATIENTS AVEC UNE STÉNOSE AORTIQUE MODÉRÉE À SÉVÈRE ET UNE FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE Lauren Basmadjian INCIDENCE ET PRÉDICTEURS DE FRACTURES POST-TRANSPLANTATION HÉPATIQUE DANS UNE COHORTE DE PATIENTS TRAITÉS AVEC BISPHOSPHONATES Bégin Marie-Josée EXPRESSION ET RÔLE DU GÈNE OSTM1 DANS LA RÉTINE Pardis Yousefi Behzadi IMPACT DU CHANGEMENT DES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DIABÈTE GESTATIONNEL AU CENTRE DES NAISSANCES DU CHUM Bérubé-Thibeault L INCIDENTALOME SURRÉNALIEN STABLE EN TAILLE ÉVOLUANT EN CARCINOME CORTICOSURRÉNALIEN 10 ANS PLUS TARD ASSOCIÉ À UN VARIANT DU GÈNE APC Pascale B L’IMPACT DE LA SUPERVISION D’UN MÉDECIN LORS DE L’ACTIVATION DU LABORATOIRE DE CATHÉTERISME ET DU DIAGNOSTIC DE STEMI PRÉHOSPITALIERS Laurie-Anne B-P MD RAN GTPASE: UNE CIBLE THÉRAPEUTIQUE PROMETTEUSE DU CANCER ÉPITHÉLIAL DE L'OVAIRE Zied Boudhraa L'IMPACT IMMUNOMODULATEUR DES SOLUTÉS CRISTALLOÏDES Frédéric Brillant-Marquis EXPLORATION DE L’EFFET DE LA SALUBRITÉ DU LOGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI SUR LA SANTÉ MENTALE DES RÉSIDENTS D’UN COMPLEXE D’HABITATION À LOYER MODIQUE Frédérique Brouillard AUTOPHAGIE ET INHIBITEURS DE PARP, UN CONCEPT INNOVANT DANS LE CANCER DE LA PROSTATE. Maxime Cahuzac 1
PRÉVALENCE DE LA MALADIE COELIAQUE CHEZ LES PATIENTS AVEC CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE. Kashi Callichurn EST-CE QUE LA PRISE EN CHARGE DE LA CHOLESTASE DE GROSSESSE NONSÉVÈRE EST ASSOCIÉE À DES COMPLICATIONS MATERNELLES ET FŒTALES ? Marie-Alexandra Campo Identification de RALDH comme marqueur fonctionnel des cellules dendritiques dérivées des monocytes CD16 + favorisant la pathogénicité lors de l'infection au VIH-1 Amélie Cattin UNE HAUTE DOSE D’IODE RADIOACTIF DANS LE TRAITEMENT ADJUVANT DU CARCINOME PAPILLAIRE À GRANDES CELLULES DE LA THYROÏDE N’EST PAS ASSOCIÉE À UNE MEILLEURE RÉPONSE Ran Cheng LA COMBINAISON DE L'EXPRESSION DES MEMBRES DE LA FAMILLE ERBB DÉMONTRE UN POTENTIEL À PRÉDIRE LA PROGRESSION DU CANCER DE LA PROSTATE Sylvie Clairefond CIBLER LA DYNAMIQUE DES MICROTUBULES VIA LE +TIP ACF7 : UN MOYEN DE LIMITER LA PROGRESSION MÉTASTATIQUE Rebecca Cusseddu L’ÂGE ET L’INDICE DE MASSE CORPORELLE N’INFLUENCENT PAS LA SURVIE DES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER DU POUMON TRAITÉS AVEC DES INHIBITEURS DU POINT DE CONTRÔLE ANTI-PD1 Lena Cvetkovic L’IMPACT DU DIABÈTE SUR LES BIOMARQUEURS SÉRIQUES EN INSUFFISANCE CARDIAQUE AVEC FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE : CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DU SPIRONOLACTONE EN INSUFFISANCE CARDIAQUE AVEC FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE (TOPCAT) Corrado De Marco L’HYPERACTIVATION DES KINASES ERK S’OPPOSE À LA PROGRESSION DE L’ADÉNOCARCINOME CANALAIRE DU PANCRÉAS PAR REPROGRAMMATION DU PHOSPHOPROTÉOME NUCLÉAIRE Xavier Deschênes-Simard 14-3-3Z: THE UNSUSPECTED REGULATOR OF ADAPTIVE THERMOGENESIS. Kadidia Diallo
2
DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE AVANT LE DÉBUT DE TRAITEMENT AVEC BIOLOGIQUE Justin Côté-Daigneault ADHERENCE TO COLONOSCOPY SURVEILLANCE GUIDELINES: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS Roupen Djinbachian ASPIRIN DOES NOT AFFECT SCD40L SIGNALING IN PLATELETS BUT REDUCES ITS POTENTIATING EFFECT ON AGGREGATION VIA INHIBITION OF MYOSIN LIGHT CHAIN Abed El Hakim El Kadiry DES CRIBLAGES CRISPR À L'ÉCHELLE DU GÉNOME RÉVÈLENT DES RÉGULATEURS POTENTIELS DE LA DORMANCE MÉTASTATIQUE DU CANCER DU SEIN Islam Elkholi COMPRENDRE LE RÔLE DE SMOC2 DANS LE CARCINOME À CELLULES RÉNALES Daniel Feng MTOR RÉGULE LA RÉPLICATION DU VIH-1 DANS LES CELLULES TCD4+ À POLARISATION TH17 Augustine Fert MÉDICATION PROBABLEMENT INAPPROPRIÉE EN PÉRIODE PRÉ-OPÉRATOIRE : ÉTUDE DESCRIPTIVE ET EXPLORATOIRE D’UNE COHORTE DE >65 ANS. Marie-France Forget PRISE EN CHARGE DES DONNEURS NEUROLOGIQUEMENT DÉCÉDÉS: REVUE SYSTÉMATIQUE DES LIGNES DIRECTRICES MONDIALES Anne Julie Frenette ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ PROSPECTIF CONTRÔLÉ À DOUBLE INSU ÉVALUANT L'EFFICACITÉ DU LASER À IMPULSIONS COURTES ND:YAG 1064NM PAR RAPPORT AU PLACEBO DANS LE TRAITEMENT DE L'ONYCHOMYCOSE D’ONGLES D’ORTEILS Carolanne Gagnon MÉCANISMES MOLÉCULAIRES RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES TUMEURS CORTICOTROPES DANS LA MALADIE DE CUSHING Ryhem Gam LA DIFFÉRENCIATION DES POPULATIONS DU PHARMACOGÈNE ADCY9 RÉVÈLE UNE INTERACTION ÉPISTATIQUE POTENTIELLE AVEC CETP Isabel Gamache
3
LOW MFGE8 EXPRESSION IS ASSOCIATED WITH WORSE PROGNOSIS IN OVARIAN, PROSTATIC AND RENAL CANCER PATIENTS Karen Geoffroy L’INHIBITION DE IKK PAR LE BX795 INDUIT UN ARRÊT DU CYCLE CELLULAIRE ET UNE INSTABILITÉ GÉNOMIQUE POUR FAVORISER LA SENESCENCE DANS LES LIGNÉES DU CANCER DE LA PROSTATE RESISTANT À LA CASTRATION Sophie Gilbert COMPARAISON DE DEUX STRATÉGIES D'APPORT EN GLUCIDES POUR AMÉLIORER LE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE PENDANT L'EXERCICE CHEZ LES ADOLESCENTS ET ADULTES ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1(RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES) Lucas Goulet Gélinas ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA PROTÉINE MFG-E8 DANS LA RÉGULATION DE L’INFLAMMATION SUITE À UNE HÉMORRAGIE SOUS-ARACHNOÏDIENNE. Typhaine Gris DÉLAI OPTIMAL POUR EFFECTUER LA PANCARTOGRAPHIE POST-TRAITEMENT À L’IODE RADIOACTIF DES CANCERS DIFFÉRENCIÉS DE LA THYROÏDE Sarah Hamidi ROLE DE LA STRUCTURE DE LA CHROMATINE DANS LA RÉGULATION DE LA RÉPARATION DE L’ADN EN RÉPONSE À UN STRESS RÉPLICATIF Hammond-Martel Ian AGRICULTURE URBAINE À MONTRÉAL : COMMENT LES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS INFLUENCENT LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ Roxanne Houde RÔLE DES MOLECULES D’ADHERENCE DANS LE DOMMAGE AUX OLIGODENDROCYTES EN SCLEROSE EN PLAQUES Hélène Jamann EXPÉRIENCE DE L’IMPLANTATION DU GÉNOTYPAGE DE LA MUTATION DPYD*2A DANS LA PRATIQUE ONCOLOGIQUE AU QUÉBEC Catherine Jolivet UN CAS D'HYPERPARATHYROÏDIE SECONDAIRE CHEZ UNE PATIENTE HÉMODIALYSÉE AYANT UNE PARATHORMONE NORMALE ET UNE PHOSPHATASE ALCALINE ÉLEVÉE Jessica Kachmar
4
RÔLE DE L’ACIDE URIQUE DANS L’ALTÉRATION DE LA PERMÉABILITÉ DE LA BARRIÈRE HÉMATOENCÉPHALIQUE ET LA NEUROINFLAMMATION SUITE AU CHOC HÉMORRAGIQUE Sydnée L'Écuyer LES PARAMÈTRES DE PRESSION ARTÉRIELLE CENTRAUX COMME PRÉDICTEURS D’ÉVÈNEMENTS CARDIOVASCULAIRES Florence Lamarche APPORT DES PATIENTS-RESSOURCE DANS L’ÉLABORATION DES TRAJECTOIRES DE SOINS EN CANCER DE LA THYROÏDE Laurence Laplante L’IMPACT DE LA DESMOPRESSINE SUR LA SURVENUE DE COMPLICATIONS POST-BIOPSIE DE REINS NATIFS : UNE ÉTUDE DE COHORTE RÉTROSPECTIVE DANS UN CENTRE HOSPITALIER TERTIAIRE Simon Leclerc LA PRÉVALENCE DE PULLULATION BACTÉRIENNE DE L’INTESTIN GRÊLE DANS LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE Jeremy Liu Chen Kiow ALK1/BMP9 AS A NEW TARGET OF THERAPY IN DIABETIC NEPHROPATHY Cindy Lora HÉTÉROGÉNÉITÉ DE L’INCIDENCE DES EFFETS SECONDAIRES À LONG TERME CHEZ LES SURVIVANTS D’UNE LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUE PÉDIATRIQUE: EXPLORATION DU RÔLE DU VIEILLISSEMENT CELLULAIRE PRÉMATURÉ Sophie Marcoux ÉCHOGRAPHIE DU QUADRICEPS CHEZ LES PATIENTS MPOC : CORRÉLATIONS AVEC LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE ET LA CONTRACTILITÉ DU DIAPHRAGME Anne-Catherine Maynard-Paquette MUTATIONS ASSOCIÉES AU NANISME DANS LE GÈNE DE RÉPLICATION DE L’ADN GINS3 Mary McQuaid IMPACTS DE LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE SUR LES SYMPTÔMES AXIAUX ET NON-MOTEURS DANS LA MALADIE DE PARKINSON Yasmine Miguel L’INACTIVATION DE HNRNP F (HETEROGENEOUS NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN F) ATTÉNUE L’HYPERTROPHIE RÉNALE ET L’HYPERFILTRATION GLOMÉRULAIRE DANS LES SOURIS DIABÉTIQUES Kana N. Miyata
5
RÔLE DES ISOFORMS DE L’IL-32 DANS LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES SUJETS INFECTÉS PAR LE VIH-1: FOCUS SUR LES CELLULES ÉPITHÉLIALES, LES CELLULES TH17 INTESTINALES ET LES CELLULES DENDRITIQUES Etiene Moreira Gabriel L’ENTRAÎNEMENT HIIT SÉCURITAIRE ET EFFICACE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CPNPC AVANCÉ SOUS TRAITEMENT SYSTÈMIQUE: RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES Myriam Nait Ajjou CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION TEMPORELLE DE L’HYPERTENSION PULMONAIRE ISOLÉE OU COMBINÉE CHEZ LES PATIENTS PRÉ ET POST TRANSPLANTATION CARDIAQUE Amine Nasri RÔLE DU TRAITEMENT NÉO-ADJUVANT DANS LE CANCER DU PANCRÉAS NONRÉSÉCABLE D’EMBLÉE : L’EXPÉRIENCE AU CHUM. Nassabein Rami LA SUREXPRESSION DE HEDGEHOG INTERACTING PROTEIN DANS LES TUBULES PROXIMAUX RÉNAUX ACCÉLÈRE LA DYSFONCTION RÉNALE DES SOURIS SUR UNE DIÈTE RICHE EN GRAS Henry Nchienzia IDENTIFICATION DE NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES DANS LES LEUCÉMIES MÉGACARYOBLASTIQUES AIGUËS Mathieu Neault L’ENZYME HÉPATIQUE ALT COMME MARQUEUR DE DYSGLYCÉMIE CHEZ LES HOMMES AVEC FIBROSE KYSTIQUE Silvia Netedu ÉTUDES DE BIO-IMPRESSION 3D D’HYDROGELS À BASE DE CHITOSANE Olivier Nicoud MODÉLISATION DE LA RÉPONSE AUX TRAITEMENTS DANS LE CANCER DE L'OVAIRE ÉPITHÉLIAL: COMPARAISON DES MODÈLES 2D, 3D ET IN-VIVO Melica Nourmoussavi DELETION OF THE PROSTAGLANDIN D2 RECEPTOR DP1 EXACERBATES AGINGASSOCIATED AND INSTABILITY-INDUCED OSTEOARTHRITIS Yassine Ouhaddi UTILITÉ DE LA CHROMOGRANINE A DANS LE DIAGNOSTIC ET LA DÉTECTION PRÉCOCE DE RÉCIDIVES DANS UNE COHORTE DE PHÉOCHROMOCYTOMES/PARAGANGLIOMES Stéfanie Parisien-La Salle 6
IMPACT PRONOSTIQUE DES SYNDROMES PARANÉOPLASIQUES EN CANCER DU POUMON À PETITES CELLULES Gabrielle Picard-Leblanc A NOVEL ANTI-ANGIOGENIC PROTEIN FOR THE THERAPY OF OCULAR NEOVASCULAR PATHOLOGIES Natalija Popovic L’IMPACT DES NOUVEAUX CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L’IADPSG SUR LES COMPLICATIONS OBSTÉTRICALES À L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT Alexandra Pouliot PRISE EN CHARGE DE L’ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE AU QUÉBEC. Catherine Pouyez FACTEURS PRONOSTIQUES DU MÉDULLOBLASTOME CHEZ LES ADULTES Maria Camila Quinones ASSOCIATION DE LA GRAISSE ÉPICARDIQUE MESURÉE PAR SCANNER CARDIAQUE AVEC LA MALADIE CORONARIENNE CHEZ LES PATIENTS VIH POSITIFS Manel Sadouni CARACTÉRISATION MOLÉCULAIRE DE LIGNÉES DE CANCER DE L'OVAIRE DE TYPE SÉREUX DE HAUT GRADE PRÉSENTANT DIFFÉRENTS PROFILS DE RÉPONSE AUX INHIBITEURS DE PARP Alex Sauriol EXPLORATION DU RÔLE DE LA DÉMÉTHYLASE KDM4A AUX AMPLIFICATEURS TRANSCRIPTIONNELS DANS LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË PÉDIATRIQUE Christina Sawchyn UN OUTIL CLINIQUE POUR ÉVALUER LE SUCCÈS DE LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE DES SINUS CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE RHINOSINUSITE CHRONIQUE Nadim Saydy CARACTÉRISATION EX VIVO DE LA RÉPONSE THÉRAPEUTIQUES DES PATIENTES ATTEINTE D'UN CANCER DE L'OVAIRE Kayla Simeone LA PHOSPHORYLCHOLINE AMÉLIORE LES PERFORMANCES DES HYDROGELS MIMÉTIQUES DU COLLAGÈNE DANS LES BRÛLURES D'ALCALI CORNÉENNES Fiona Simpson
7
PRÉCISION DE LA LOCALISATION DES INFILTRATIONS ÉCHOGUIDÉES DU NERF PUDENDAL À L’ÉPINE ISCHIATIQUE OU AU CANAL D’ALCOCK : ÉTUDE SUR CADAVRES Béatrice Soucy ÉTUDE DU RELARGAGE D’ATP INDUIT PAR LE GONFLEMENT DES POUMONS DE RAT EX VIVO PAR LA BIOLUMINESCENCE Ju JingTan LES EFFETS DE LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE SUR L'APATHIE CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE PARKINSON: UNE ÉTUDE PROSPECTIVE Bouchra Tannir LES PROTÉINES ELMO1/2 RÉGULENT LA FUSION DES MYOBLASTES DURANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE Viviane Tran L'INHIBITION DES SIRTUINES GÉNÈRE UN STRESS TOXIQUE RAD51DÉPENDANT LORS DE LA RÉPLICATION DE L'ADN Roch Tremblay ALK1 SIGNALING PROMOTES THE NORMALIZATION OF TUMOR BLOOD VESSELS Claire Viallard L’EFFICACITÉ DE LA LIDOCAÏNE TOPIQUE DANS LA MANOMÉTRIE ŒSOPHAGIENNE ET LA PH-MÉTRIE AMBULATOIRE George Wahba PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES POLYPES COLORECTAUX: RÉSULTATS D’UN QUESTIONNAIRE INTERNATIONAL Philippe Willems IMPACT PRONOSTIQUE DE LA PSEUDO-PROGRESSION DANS LE GLIOBLASTOME MULTIFORME Elie Zeidan L’INACTIVATION DE NRF2 (NUCLEAR FACTOR ERYTHROID 2-RELATED FACTOR 2) DANS LES SOURIS DB/DB PERMET D’ATTÉNUER L’HYPERGLYCÉMIE, L’HYPERTENSION ET LA NÉPHROPATHIE VIA UNE RÉGULATION NÉGATIVE DE L’EXPRESSION RÉNALE DE SGLT2 (SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2) Shuiling Zhao
8
9
La signalisation BMP9/Alk1 dans la prévention de la perméabilité rétinienne hyperglycémique Naoufal Akla1,2,4,5, Popovic Nataljia1,3,5, Cindy Lora G1,3,5, Claire Viallard1,5,6, Sapieha Przemyslaw1,2,4,5, Bruno Larrivée1,3,4,5,6 1
Université de Montréal, 2Department of Biochemistry, 3Department of Biomedical Sciences, 4Department of Ophthalmology, 5Maisonneuve-Rosemont Hospital Research Center, 6Department of Molecular Biology But: L’œdème maculaire diabétique (OMD) est une cause majeure de déficience visuelle provoquée par la dégradation de la barrière hémato-rétinienne menant à l’hyperperméabilité vasculaire. Les anti-VEGF, bien qu’efficaces, sont associés à des effets secondaires potentiels sévères. La découverte de cibles protectrices spécifiques à l’endothélium rétablissant la stabilité endothéliale rétinienne pourrait fournir une alternative thérapeutique. La signalisation par la protéine circulante BMP9 via son récepteur spécifique à l’endothélium ALK1, est connue pour son rôle dans le maintien de la quiescence vasculaire. Cependant, sa capacité à protéger l’endothélium et à prévenir la perméabilité vasculaire n’a pas été testée dans le diabète. Méthodologie: Nous avons étudié la signalisation BMP9/ALK1 dans l’endothélium hyperglycémique et son effet sur la perméabilité rétinienne dans un modèle murin de diabète de type 1. La perméabilité rétinienne quantifiée par l’essai Miles et la surexpression de la BMP9 a été réalisée vecteurs adénoviraux. Résultats: L’activation d’ALK1 par la surexpression BMP9 chez les souris diabétiques a restauré la perméabilité physiologique en maintenant l’intégrité des jonctions interendothéliales, en partie en limitant l’action de la signalisation au VEGF. Nous avons également observé que la surexpression de BMP9 pouvait protéger l’endothélium rétinien chez les souris diabétiques en améliorant le contrôle glycémique sur une période de 4 semaines. Cet effet serait régulé principalement par l’inhibition de la gluconéogenèse hépatique. Conclusion : Nous avons démontré que la signalisation BMP9 agit au niveau vasculaire et métabolique pour protéger l’intégrité vasculaire de la rétine et pourrait donc être d’intérêt dans le développement de futures stratégies thérapeutiques ciblant l’OMD.
10
Le GDF-15 est associé à la capacité fonctionnelle et la dysfonction ventriculaire chez les patients avec une sténose aortique modérée à sévère et une fraction d’éjection préservée Lauren Basmadjian1, François Simard2, Nadia Bouabdallaoui2, Eileen O'Meara2, Normand Racine2, Michel White2, Anique Ducharme2, Martin Sirois2, Anita Asgar2, Reda Ibrahim2, Jean-François Dorval2, Raoul Bonan2, Raymond Cartier2, Jessica Forcillo2, Ismail ElHamamsy2, Christine Henri2 1
Université de Montréal, 2Institut de Cardiologie de Montréal
Introduction : Chez les patients atteints de sténose aortique (SA) sévère, le remplacement valvulaire (RVA) est indiqué lors de l’apparition de symptômes ou une baisse de la fraction d’éjection (FEVG). Le remodelage ventriculaire et la dysfonction diastolique surviennent souvent avant les symptômes et un RVA plus précoce pourrait être bénéfique. L’évaluation du risque chez ces patients demeure difficile et le GDF-15 pourrait aider.
Objectif : Évaluer l’association entre le GDF-15 et les facteurs de mauvais pronostique connus en SA.
Méthodes : Le GDF-15 a été mesuré chez 70 patients avec une SA modérée-sévère (AVA45%). Les patients ont été séparé en deux groupes, «GDF-15-bas» et «GDF-15-élevé», selon la valeur médiane de la cohorte. Les groupes ont été comparé; comorbidités cardiovasculaires, test de marche de six-minutes (6MWT), vitesse de marche sur 5m (5mGS), paramètres échocardiographiques de sévérité de SA et de dysfonction ventriculaire.
Résultats : L’âge moyen de la cohorte était de 68+/-13 ans avec une valeur médiane de GDF-15 de 1050 [688-1591pg/mL]. Les patients «GDF-15-élevé» étaient plus souvent masculin, âgé, et co-morbide. Une valeur élevée de GDF-15 était associée à une dysfonction ventriculaire; volume d’éjection et «strain» ventriculaire plus bas, et ratio E/e’ et volume auriculaire gauche plus élevés. Ces patients avaient une plus grande atteinte fonctionnelle (moins bonne performance au 6MWT et 5mGS).
Conclusion: Un GDF-15 élevé était associé à une atteinte fonctionnelle et une dysfonction ventriculaire. Le GDF-15 combine potentiellement ces prédicteurs de mauvais pronostic en un biomarqueur objectif. Plus d’études sont nécessaires. 11
INCIDENCE ET PRÉDICTEURS DE FRACTURES POSTTRANSPLANTATION HÉPATIQUE DANS UNE COHORTE DE PATIENTS TRAITÉS AVEC BISPHOSPHONATES Bégin MJ1, Ste-Marie LG1, Huard G2, Chartrand R3, Dorais M4, Rakel A1 1
Service d’Endocrinologie, Département de Médecine, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 2Service d’Hépatologie, Département de Médecine, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 3Service de Médecine Nucléaire, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 4StatSciences Inc., Notre-Dame-de-l’île Perrot, QC, Canada Introduction: La perte osseuse est significative lors des 6 mois suivant une greffe hépatique et est associée à une augmentation du risque fracturaire. L’utilisation de bisphosphonates prévient cette diminution de la densité minérale osseuse (DMO) et réduit le risque fracturaire. L’objectif principal de cette étude était de déterminer l’incidence de fracture au cours des trois années suivant une première greffe hépatique chez des patients ayant reçu une prescription de bisphosphonates au congé de leur hospitalisation. L’objectif secondaire était d’étudier les prédicteurs de fracture chez ces patients.
Méthodes: Une étude de cohorte rétrospective a été menée auprès de patients greffés hépatiques entre 2012 et 2016 au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal. Les fractures vertébrales et non-vertébrales ont été incluses.
Résultats: 155 patients ont été inclus dans l’étude (âge médian 57 ans; 29.7% femmes). En pré-greffe, 14 patients (8.9%) avaient un T-score ≤ -2.5 à la DMO et 23 patients (14.8%) avaient une histoire de fracture de fragilité. L’incidence cumulative de fractures était de 17.5% à 36 mois avec un temps médian à la première fracture de 10 mois (3-22 mois). Les facteurs prédictifs de fractures en analyse multivariée étaient l’âge > 60 ans (HR 2.41; 95% CI, 1.06-5.49), le sexe féminin (HR 2.27; 95% CI, 1.00-5.14) et le new-onset diabetes after transplantation (NODAT) (HR 2.81; 95% CI, 1.23-6.45).
Conclusion: Les fractures sont une complication précoce et fréquente de la greffe hépatique chez les patients traités avec bisphosphonates, particulièrement chez les patients plus âgés, de sexe féminin et atteints d’un NODAT.
12
EXPRESSION ET RÔLE DU GÈNE OSTM1 DANS LA RÉTINE pardis yousefi behzadi1, Monica Pata2, Jean Vacher1,2 1
Université de Montréal, 2Institut de Recherches Cliniques de Montréal (IRCM)
Introduction: Nous avons caractérisé le gène Ostm1 responsable de la mutation ostéopétrotique spontanée grey-lethal (gl) chez la souris. La complémentation fonctionnelle des défauts hématopoiétiques a été obtenue dans les souris transgéniques PU.1-Ostm1-gl/gl mais ces souris meurent prématurément avec une neurodégénérescence sévére. Cette perte cellulaire affecte le système nerveux central dans son ensemble incluant la rétine. Méthodes Pour définir le rôle d’Ostm1 dans la rétine, nous avons caractérisé son expression dans cet organe et induit la perte de fonction d’Ostm1 dans l’épithélium pigmenté (RPE). Résultats: Des analyses PCR démontrent une expression d’Ostm1 dans l’œil total et enrichie dans la neurorétine et dans le RPE. Après avoir défini, avec des marqueurs protéiques spécifiques, les sous-populations cellulaires de la rétine, l’hybridation in situ détecte l’expression préférentielle d’Ostm1 dans la couche ganglionnaire, la couche nucléaire interne (INL) et le RPE. Basé sur ce profil d’expression, nous avons induit dans un premier temps la perte de function d’Ostm1 spécifiquement dans le RPE. Les souris Ostm1loxlox générées dans le laboratoire ont été croisées avec la lignée Bestrophine1-Cre (Best1-Cre). L’expression de la recombinase Cre est spécifique au RPE et n’est pas toxique. La perte d’expression d’Ostm1 dans le RPE se traduit par une perte graduelle des photorécepteurs avec l’âge indiquant un défaut fonctionnel du RPE. Conclusion: Ces résultats préliminaires suggèrent que l’expression post-natale d’Ostm1 dans le RPE est essentielle au maintien et au renouvellement des photorécepteurs de la rétine.
13
IMPACT DU CHANGEMENT DES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DIABÈTE GESTATIONNEL AU CENTRE DES NAISSANCES DU CHUM Bérubé-Thibeault L1, Arbour A1, El-Outari A1, Nadeau S1, Wo BL2,3, Godbout A1,3, Grand’Maison S1,3, Mahone M1,3 1
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Montréal, Québec, 2Département de gynécologie-obstétrique du CHUM, Montréal, Québec, 3Centre de recherche du CHUM, Montréal, Québec Introduction : Le dépistage pour le diabète gestationnel (DG) au CHUM était basé sur des critères plus stricts que ceux proposés par l’Organisation mondiale de la Santé en 2013. En mars 2015, les critères ont été harmonisés. Nous évaluons si le taux de complication de grossesse au CHUM augmente en utilisant des critères moins stricts.
Méthodes : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective chez les femmes avec grossesse unique dépistées pour le DG entre mars 2015 et février 2016 avec le test d’hyperglycémie orale provoquée (HGOP) de 75g. 1303 femmes ont été inclues et trois groupes ont été analysés : Groupe 1, HGOP normal avec les anciens et nouveaux critères ; Groupe 2, HGOP normal avec les nouveaux critères seulement ; Groupe 3, DG avec les nouveaux critères. L’issue primaire est un composé de : poids de naissance ≥ 90e percentile, césarienne en travail, pré-éclampsie et hypertension gestationnelle.
Résultats : Le groupe 2 a un taux de complication plus élevé (47 patientes [37.2%]) que les femmes avec DG (53 patientes [23.6%]) ou le groupe contrôle (162 patientes [26.6%]). Le groupe 2 a un taux de complication 1.63 fois plus élevé (1.63; 95% intervalle de confiance, 1.08 à 2.46) que le groupe contrôle.
Conclusion : Nos résultats suggèrent un taux de complication plus élevé chez les femmes qui ne sont plus considérées DG en utilisant des critères moins stricts. Des prédicteurs anténataux sont requis afin d’identifier les femmes à risque et implanter des stratégies pour améliorer les issues.
14
INCIDENTALOME SURRÉNALIEN STABLE EN TAILLE ÉVOLUANT EN CARCINOME CORTICOSURRÉNALIEN 10 ANS PLUS TARD ASSOCIÉ À UN VARIANT DU GÈNE APC Pascale B1, Nadia G 1, Catherine A 1, Gilles C1, Mathieu L2, Irina B 6, Catherine B 1, Serge N2, Fred S 3, Katia C. 1, Zaki El H 4, Harold JO 5, Isabelle B1,4 1
Service d'Endocrinologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 2Département de Pathologie, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 3 Service d'Urologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 4Service de Génétique, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 5Service d'Oncologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 6Division of Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, MN Introduction : Les lignes directrices récentes sur les incidentalomes surrénaliens stipulent qu’une masse de nature indéterminée qui n’est pas retirée chirurgicalement devrait être recontrôlée par imagerie 6-12 mois plus tard. Si la masse est stable et non fonctionnelle, le suivi pourrait être cessé. Cas : Nous rapportons le cas d’une Canadienne Française de 32 ans qui a été évaluée en 2006 pour un incidentalome surrénalien gauche de 27x20 mm. Le bilan hormonal initial était normal. Des imageries de contrôle ont été effectuées jusqu’en 2009, et la masse est demeurée stable, suggérant le diagnostic d’adénome. Perdue au suivi, la patiente est hospitalisée en 2016 pour des coliques néphrétiques. La masse surrénalienne gauche mesure alors 90x82 mm et deux lésions hépatiques sont identifiées. Le bilan hormonal démontre un hypercorticisme et un hyperandrogénisme. Le diagnostic de carcinome corticosurrénalien avec métastases hépatiques a été confirmé en pathologie. Méthodes : Des analyses immunohistochimiques ont été réalisées sur le tissu tumoral et un panel génétique oncologique a été fait sur l’ADN leucocytaire de la patiente après son consentement. Résultats :
15
Une accumulation d’IGF-2 et de β-caténine a été retrouvée dans le tissu tumoral. Un variant génétique germinale sur l’exon 16 du gène APC de signification inconnue a été identifié (c.2414G>A, p.Arg805Gln) (rs200593940). Conclusion : Un incidentalome surrénalien de petite taille qui demeure stable pendant 4 ans peut évoluer en carcinome corticosurrénalien après plusieurs années. Une meilleure caractérisation génétique de ces patients pourra conduire à une meilleure compréhension de cette évolution inhabituelle.
16
L’IMPACT DE LA SUPERVISION D’UN MÉDECIN LORS DE L’ACTIVATION DU LABORATOIRE DE CATHÉTERISME ET DU DIAGNOSTIC DE STEMI PRÉHOSPITALIERS Laurie-Anne B-P MD1,2, Alexis M MD SM1,2, Christine C P MD3, Alexandra B MD4, Samer M MD1,2, André K MD2, Éric Q MD5, François G MD2, Brian J P MDCM SM1,2 1
Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), Montréal, Québec, 2Centre Cardiovasculaire du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Montréal, Québec, 3Hôpital Pierre-Boucher, Longueuil, Québec, 4 University of Alberta, Edmonton, Alberta, 5Hôpital Charles-Lemoyne, Greenfield Park, Québec Introduction : L’identification du STEMI sur le terrain et l’activation pré-hospitalière du centre d’hémodynamie (CH) est la méthode de référence pour diminuer le temps d’ischémie. Nous avons voulu déterminer si la supervision d’un médecin améliore la performance diagnostique des systèmes d’activation pré-hospitalière et l’impact sur les délais de traitement.
Méthodes : Entre 2012 et 2015, tout patient dans deux régions avec une plainte principale de douleur thoracique ou de dyspnée a eu un électrocardiogramme (ECG) sur le champ. Un diagnostic automatisé de STEMI a engendré soit une activation directe du CH ou une transmission de l’ECG à un urgentologue pour validation avant l’activation. La performance du système a été évaluée en termes de faux positif (FP) et d’activation inappropriée (AI) ainsi que de la proportion des patients avec un temps de contact au dispositif (first medical contact to device time ; C2D) ≤90 minutes.
Résultats : 488 activations ont été analysées (311 automatique ; 177 avec supervision). La supervision d’un médecin a diminué de 85% les IA (7% to 1%; p=0,012), mais a prolongé le temps de C2D médian avec une plus petite proportion atteignant le C2D cible (76% vs 60%; p 20 mmHg. L'impact de cette définiton sur la prévalence de l'HTP n'a pas encore été étudié. L'impact de l'HTP sur la survie post-TX à 30 jours et a très long terme demeure encore nébuleuse. Dans cette étude, nous avons invistigué les caractéristiques cliniques et hémodynamiques des patients avec HTP en pré-TX en utilisant les nouvelles définitions de l'ISHLT chez une cohorte de patient transplanté entre 1983-2014. Nous avons aussi évalué l'impact de la présence et de la sévérité de l'HTP sur la mortalité et les évenement cardiaque majeurs (MACE) en post-TX à 30 jours, 1 an et à long terme.
66
Rôle du traitement néo-adjuvant dans le cancer du pancréas non-résécable d’emblée : l’expérience au CHUM. Nassabein. R2, Richard. C3, routy bertrand1,2, Ayoub. J-P2, Aubin. F2, Campeau. M-P2, david donath2, delouya guila2, micheal dagenais2, Réal Lapointe2, richard létourneau2, Simon Turcotte1,2, marylene plasse2, Franck Vandenbroucke-Menu2, olivié damien2, roy andré2, mustapha tehfé2 1
CRCHUM/ Université de Montréal, 2CHUM, 3institut gustave roussy
Introduction: La résection chirurgicale suivie d’une chimiothérapie adjuvante est le traitement standard du cancer du pancréas de stade précoce. Pour les tumeurs « Borderline » (BR) et localement avancées (LA), la résection avec marges saines représente un important défi chirurgical. Le rôle ainsi que le type de traitement préopératoire restent à établir pour les cancers considérés non-résécables d’emblée. Méthodes : Nous avons revu rétrospectivement les cas des patients ayant reçu au CHUM des traitements néo-adjuvants (NAT) pour des tumeurs pancréatiques BR et LA. Les taux de survie étaient estimés selon la méthode Kaplan-Meier. L’analyse de sous-groupe, le risque relatif et l’intervalle de confiance étaient calculés par un modèle de Cox à risques proportionnels. Résultats: 90 patients (50 BR, 40 LR) avaient reçu un NAT au CHUM entre 2009 et 2017. La chimiothérapie était le seul NAT chez 51 patients (56,6%), la radio-chimiothérapie seule chez 23 patients (25.3%) et 16 patients (17,7%) avaient reçu un traitement séquentiel de chimiothérapie et radio-chimiothérapie. La résection tumorale a eu lieu chez 44 patients, dont 32 patients BR (R0: 68.7%) et 12 patients LA (R0: 75%). La survie sans maladie (SSM) des patients réséqués était de 12,3 mois. SSPm et SGm des patients réséqués étaient de 29 et 41,7 mois, comparées à 10 et 15,7 mois des patients non-réséqués, respectivement (p
PRÉVALENCE DE LA MALADIE COELIAQUE CHEZ LES PATIENTS AVEC CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE. Kashi Callichurn EST-CE QUE LA PRISE EN CHARGE DE LA CHOLESTASE DE GROSSESSE NONSÉVÈRE EST ASSOCIÉE À DES COMPLICATIONS MATERNELLES ET FŒTALES ? Marie-Alexandra Campo Identification de RALDH comme marqueur fonctionnel des cellules dendritiques dérivées des monocytes CD16 + favorisant la pathogénicité lors de l'infection au VIH-1 Amélie Cattin UNE HAUTE DOSE D’IODE RADIOACTIF DANS LE TRAITEMENT ADJUVANT DU CARCINOME PAPILLAIRE À GRANDES CELLULES DE LA THYROÏDE N’EST PAS ASSOCIÉE À UNE MEILLEURE RÉPONSE Ran Cheng LA COMBINAISON DE L'EXPRESSION DES MEMBRES DE LA FAMILLE ERBB DÉMONTRE UN POTENTIEL À PRÉDIRE LA PROGRESSION DU CANCER DE LA PROSTATE Sylvie Clairefond CIBLER LA DYNAMIQUE DES MICROTUBULES VIA LE +TIP ACF7 : UN MOYEN DE LIMITER LA PROGRESSION MÉTASTATIQUE Rebecca Cusseddu L’ÂGE ET L’INDICE DE MASSE CORPORELLE N’INFLUENCENT PAS LA SURVIE DES PATIENTS ATTEINTS DU CANCER DU POUMON TRAITÉS AVEC DES INHIBITEURS DU POINT DE CONTRÔLE ANTI-PD1 Lena Cvetkovic L’IMPACT DU DIABÈTE SUR LES BIOMARQUEURS SÉRIQUES EN INSUFFISANCE CARDIAQUE AVEC FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE : CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DU SPIRONOLACTONE EN INSUFFISANCE CARDIAQUE AVEC FRACTION D’ÉJECTION PRÉSERVÉE (TOPCAT) Corrado De Marco L’HYPERACTIVATION DES KINASES ERK S’OPPOSE À LA PROGRESSION DE L’ADÉNOCARCINOME CANALAIRE DU PANCRÉAS PAR REPROGRAMMATION DU PHOSPHOPROTÉOME NUCLÉAIRE Xavier Deschênes-Simard 14-3-3Z: THE UNSUSPECTED REGULATOR OF ADAPTIVE THERMOGENESIS. Kadidia Diallo
2
DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE AVANT LE DÉBUT DE TRAITEMENT AVEC BIOLOGIQUE Justin Côté-Daigneault ADHERENCE TO COLONOSCOPY SURVEILLANCE GUIDELINES: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS Roupen Djinbachian ASPIRIN DOES NOT AFFECT SCD40L SIGNALING IN PLATELETS BUT REDUCES ITS POTENTIATING EFFECT ON AGGREGATION VIA INHIBITION OF MYOSIN LIGHT CHAIN Abed El Hakim El Kadiry DES CRIBLAGES CRISPR À L'ÉCHELLE DU GÉNOME RÉVÈLENT DES RÉGULATEURS POTENTIELS DE LA DORMANCE MÉTASTATIQUE DU CANCER DU SEIN Islam Elkholi COMPRENDRE LE RÔLE DE SMOC2 DANS LE CARCINOME À CELLULES RÉNALES Daniel Feng MTOR RÉGULE LA RÉPLICATION DU VIH-1 DANS LES CELLULES TCD4+ À POLARISATION TH17 Augustine Fert MÉDICATION PROBABLEMENT INAPPROPRIÉE EN PÉRIODE PRÉ-OPÉRATOIRE : ÉTUDE DESCRIPTIVE ET EXPLORATOIRE D’UNE COHORTE DE >65 ANS. Marie-France Forget PRISE EN CHARGE DES DONNEURS NEUROLOGIQUEMENT DÉCÉDÉS: REVUE SYSTÉMATIQUE DES LIGNES DIRECTRICES MONDIALES Anne Julie Frenette ESSAI CLINIQUE RANDOMISÉ PROSPECTIF CONTRÔLÉ À DOUBLE INSU ÉVALUANT L'EFFICACITÉ DU LASER À IMPULSIONS COURTES ND:YAG 1064NM PAR RAPPORT AU PLACEBO DANS LE TRAITEMENT DE L'ONYCHOMYCOSE D’ONGLES D’ORTEILS Carolanne Gagnon MÉCANISMES MOLÉCULAIRES RESPONSABLES DU DÉVELOPPEMENT DES TUMEURS CORTICOTROPES DANS LA MALADIE DE CUSHING Ryhem Gam LA DIFFÉRENCIATION DES POPULATIONS DU PHARMACOGÈNE ADCY9 RÉVÈLE UNE INTERACTION ÉPISTATIQUE POTENTIELLE AVEC CETP Isabel Gamache
3
LOW MFGE8 EXPRESSION IS ASSOCIATED WITH WORSE PROGNOSIS IN OVARIAN, PROSTATIC AND RENAL CANCER PATIENTS Karen Geoffroy L’INHIBITION DE IKK PAR LE BX795 INDUIT UN ARRÊT DU CYCLE CELLULAIRE ET UNE INSTABILITÉ GÉNOMIQUE POUR FAVORISER LA SENESCENCE DANS LES LIGNÉES DU CANCER DE LA PROSTATE RESISTANT À LA CASTRATION Sophie Gilbert COMPARAISON DE DEUX STRATÉGIES D'APPORT EN GLUCIDES POUR AMÉLIORER LE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE PENDANT L'EXERCICE CHEZ LES ADOLESCENTS ET ADULTES ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1(RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES) Lucas Goulet Gélinas ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA PROTÉINE MFG-E8 DANS LA RÉGULATION DE L’INFLAMMATION SUITE À UNE HÉMORRAGIE SOUS-ARACHNOÏDIENNE. Typhaine Gris DÉLAI OPTIMAL POUR EFFECTUER LA PANCARTOGRAPHIE POST-TRAITEMENT À L’IODE RADIOACTIF DES CANCERS DIFFÉRENCIÉS DE LA THYROÏDE Sarah Hamidi ROLE DE LA STRUCTURE DE LA CHROMATINE DANS LA RÉGULATION DE LA RÉPARATION DE L’ADN EN RÉPONSE À UN STRESS RÉPLICATIF Hammond-Martel Ian AGRICULTURE URBAINE À MONTRÉAL : COMMENT LES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS INFLUENCENT LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ Roxanne Houde RÔLE DES MOLECULES D’ADHERENCE DANS LE DOMMAGE AUX OLIGODENDROCYTES EN SCLEROSE EN PLAQUES Hélène Jamann EXPÉRIENCE DE L’IMPLANTATION DU GÉNOTYPAGE DE LA MUTATION DPYD*2A DANS LA PRATIQUE ONCOLOGIQUE AU QUÉBEC Catherine Jolivet UN CAS D'HYPERPARATHYROÏDIE SECONDAIRE CHEZ UNE PATIENTE HÉMODIALYSÉE AYANT UNE PARATHORMONE NORMALE ET UNE PHOSPHATASE ALCALINE ÉLEVÉE Jessica Kachmar
4
RÔLE DE L’ACIDE URIQUE DANS L’ALTÉRATION DE LA PERMÉABILITÉ DE LA BARRIÈRE HÉMATOENCÉPHALIQUE ET LA NEUROINFLAMMATION SUITE AU CHOC HÉMORRAGIQUE Sydnée L'Écuyer LES PARAMÈTRES DE PRESSION ARTÉRIELLE CENTRAUX COMME PRÉDICTEURS D’ÉVÈNEMENTS CARDIOVASCULAIRES Florence Lamarche APPORT DES PATIENTS-RESSOURCE DANS L’ÉLABORATION DES TRAJECTOIRES DE SOINS EN CANCER DE LA THYROÏDE Laurence Laplante L’IMPACT DE LA DESMOPRESSINE SUR LA SURVENUE DE COMPLICATIONS POST-BIOPSIE DE REINS NATIFS : UNE ÉTUDE DE COHORTE RÉTROSPECTIVE DANS UN CENTRE HOSPITALIER TERTIAIRE Simon Leclerc LA PRÉVALENCE DE PULLULATION BACTÉRIENNE DE L’INTESTIN GRÊLE DANS LA CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE Jeremy Liu Chen Kiow ALK1/BMP9 AS A NEW TARGET OF THERAPY IN DIABETIC NEPHROPATHY Cindy Lora HÉTÉROGÉNÉITÉ DE L’INCIDENCE DES EFFETS SECONDAIRES À LONG TERME CHEZ LES SURVIVANTS D’UNE LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUE PÉDIATRIQUE: EXPLORATION DU RÔLE DU VIEILLISSEMENT CELLULAIRE PRÉMATURÉ Sophie Marcoux ÉCHOGRAPHIE DU QUADRICEPS CHEZ LES PATIENTS MPOC : CORRÉLATIONS AVEC LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE ET LA CONTRACTILITÉ DU DIAPHRAGME Anne-Catherine Maynard-Paquette MUTATIONS ASSOCIÉES AU NANISME DANS LE GÈNE DE RÉPLICATION DE L’ADN GINS3 Mary McQuaid IMPACTS DE LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE SUR LES SYMPTÔMES AXIAUX ET NON-MOTEURS DANS LA MALADIE DE PARKINSON Yasmine Miguel L’INACTIVATION DE HNRNP F (HETEROGENEOUS NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN F) ATTÉNUE L’HYPERTROPHIE RÉNALE ET L’HYPERFILTRATION GLOMÉRULAIRE DANS LES SOURIS DIABÉTIQUES Kana N. Miyata
5
RÔLE DES ISOFORMS DE L’IL-32 DANS LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES SUJETS INFECTÉS PAR LE VIH-1: FOCUS SUR LES CELLULES ÉPITHÉLIALES, LES CELLULES TH17 INTESTINALES ET LES CELLULES DENDRITIQUES Etiene Moreira Gabriel L’ENTRAÎNEMENT HIIT SÉCURITAIRE ET EFFICACE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE CPNPC AVANCÉ SOUS TRAITEMENT SYSTÈMIQUE: RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES Myriam Nait Ajjou CARACTÉRISTIQUES ET ÉVOLUTION TEMPORELLE DE L’HYPERTENSION PULMONAIRE ISOLÉE OU COMBINÉE CHEZ LES PATIENTS PRÉ ET POST TRANSPLANTATION CARDIAQUE Amine Nasri RÔLE DU TRAITEMENT NÉO-ADJUVANT DANS LE CANCER DU PANCRÉAS NONRÉSÉCABLE D’EMBLÉE : L’EXPÉRIENCE AU CHUM. Nassabein Rami LA SUREXPRESSION DE HEDGEHOG INTERACTING PROTEIN DANS LES TUBULES PROXIMAUX RÉNAUX ACCÉLÈRE LA DYSFONCTION RÉNALE DES SOURIS SUR UNE DIÈTE RICHE EN GRAS Henry Nchienzia IDENTIFICATION DE NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES DANS LES LEUCÉMIES MÉGACARYOBLASTIQUES AIGUËS Mathieu Neault L’ENZYME HÉPATIQUE ALT COMME MARQUEUR DE DYSGLYCÉMIE CHEZ LES HOMMES AVEC FIBROSE KYSTIQUE Silvia Netedu ÉTUDES DE BIO-IMPRESSION 3D D’HYDROGELS À BASE DE CHITOSANE Olivier Nicoud MODÉLISATION DE LA RÉPONSE AUX TRAITEMENTS DANS LE CANCER DE L'OVAIRE ÉPITHÉLIAL: COMPARAISON DES MODÈLES 2D, 3D ET IN-VIVO Melica Nourmoussavi DELETION OF THE PROSTAGLANDIN D2 RECEPTOR DP1 EXACERBATES AGINGASSOCIATED AND INSTABILITY-INDUCED OSTEOARTHRITIS Yassine Ouhaddi UTILITÉ DE LA CHROMOGRANINE A DANS LE DIAGNOSTIC ET LA DÉTECTION PRÉCOCE DE RÉCIDIVES DANS UNE COHORTE DE PHÉOCHROMOCYTOMES/PARAGANGLIOMES Stéfanie Parisien-La Salle 6
IMPACT PRONOSTIQUE DES SYNDROMES PARANÉOPLASIQUES EN CANCER DU POUMON À PETITES CELLULES Gabrielle Picard-Leblanc A NOVEL ANTI-ANGIOGENIC PROTEIN FOR THE THERAPY OF OCULAR NEOVASCULAR PATHOLOGIES Natalija Popovic L’IMPACT DES NOUVEAUX CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L’IADPSG SUR LES COMPLICATIONS OBSTÉTRICALES À L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT Alexandra Pouliot PRISE EN CHARGE DE L’ACHALASIE DE L’ŒSOPHAGE AU QUÉBEC. Catherine Pouyez FACTEURS PRONOSTIQUES DU MÉDULLOBLASTOME CHEZ LES ADULTES Maria Camila Quinones ASSOCIATION DE LA GRAISSE ÉPICARDIQUE MESURÉE PAR SCANNER CARDIAQUE AVEC LA MALADIE CORONARIENNE CHEZ LES PATIENTS VIH POSITIFS Manel Sadouni CARACTÉRISATION MOLÉCULAIRE DE LIGNÉES DE CANCER DE L'OVAIRE DE TYPE SÉREUX DE HAUT GRADE PRÉSENTANT DIFFÉRENTS PROFILS DE RÉPONSE AUX INHIBITEURS DE PARP Alex Sauriol EXPLORATION DU RÔLE DE LA DÉMÉTHYLASE KDM4A AUX AMPLIFICATEURS TRANSCRIPTIONNELS DANS LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË PÉDIATRIQUE Christina Sawchyn UN OUTIL CLINIQUE POUR ÉVALUER LE SUCCÈS DE LA CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE DES SINUS CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE RHINOSINUSITE CHRONIQUE Nadim Saydy CARACTÉRISATION EX VIVO DE LA RÉPONSE THÉRAPEUTIQUES DES PATIENTES ATTEINTE D'UN CANCER DE L'OVAIRE Kayla Simeone LA PHOSPHORYLCHOLINE AMÉLIORE LES PERFORMANCES DES HYDROGELS MIMÉTIQUES DU COLLAGÈNE DANS LES BRÛLURES D'ALCALI CORNÉENNES Fiona Simpson
7
PRÉCISION DE LA LOCALISATION DES INFILTRATIONS ÉCHOGUIDÉES DU NERF PUDENDAL À L’ÉPINE ISCHIATIQUE OU AU CANAL D’ALCOCK : ÉTUDE SUR CADAVRES Béatrice Soucy ÉTUDE DU RELARGAGE D’ATP INDUIT PAR LE GONFLEMENT DES POUMONS DE RAT EX VIVO PAR LA BIOLUMINESCENCE Ju JingTan LES EFFETS DE LA STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE SUR L'APATHIE CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE PARKINSON: UNE ÉTUDE PROSPECTIVE Bouchra Tannir LES PROTÉINES ELMO1/2 RÉGULENT LA FUSION DES MYOBLASTES DURANT LE DÉVELOPPEMENT ET LA RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE Viviane Tran L'INHIBITION DES SIRTUINES GÉNÈRE UN STRESS TOXIQUE RAD51DÉPENDANT LORS DE LA RÉPLICATION DE L'ADN Roch Tremblay ALK1 SIGNALING PROMOTES THE NORMALIZATION OF TUMOR BLOOD VESSELS Claire Viallard L’EFFICACITÉ DE LA LIDOCAÏNE TOPIQUE DANS LA MANOMÉTRIE ŒSOPHAGIENNE ET LA PH-MÉTRIE AMBULATOIRE George Wahba PRISE EN CHARGE CLINIQUE DES POLYPES COLORECTAUX: RÉSULTATS D’UN QUESTIONNAIRE INTERNATIONAL Philippe Willems IMPACT PRONOSTIQUE DE LA PSEUDO-PROGRESSION DANS LE GLIOBLASTOME MULTIFORME Elie Zeidan L’INACTIVATION DE NRF2 (NUCLEAR FACTOR ERYTHROID 2-RELATED FACTOR 2) DANS LES SOURIS DB/DB PERMET D’ATTÉNUER L’HYPERGLYCÉMIE, L’HYPERTENSION ET LA NÉPHROPATHIE VIA UNE RÉGULATION NÉGATIVE DE L’EXPRESSION RÉNALE DE SGLT2 (SODIUM-GLUCOSE CO-TRANSPORTER 2) Shuiling Zhao
8
9
La signalisation BMP9/Alk1 dans la prévention de la perméabilité rétinienne hyperglycémique Naoufal Akla1,2,4,5, Popovic Nataljia1,3,5, Cindy Lora G1,3,5, Claire Viallard1,5,6, Sapieha Przemyslaw1,2,4,5, Bruno Larrivée1,3,4,5,6 1
Université de Montréal, 2Department of Biochemistry, 3Department of Biomedical Sciences, 4Department of Ophthalmology, 5Maisonneuve-Rosemont Hospital Research Center, 6Department of Molecular Biology But: L’œdème maculaire diabétique (OMD) est une cause majeure de déficience visuelle provoquée par la dégradation de la barrière hémato-rétinienne menant à l’hyperperméabilité vasculaire. Les anti-VEGF, bien qu’efficaces, sont associés à des effets secondaires potentiels sévères. La découverte de cibles protectrices spécifiques à l’endothélium rétablissant la stabilité endothéliale rétinienne pourrait fournir une alternative thérapeutique. La signalisation par la protéine circulante BMP9 via son récepteur spécifique à l’endothélium ALK1, est connue pour son rôle dans le maintien de la quiescence vasculaire. Cependant, sa capacité à protéger l’endothélium et à prévenir la perméabilité vasculaire n’a pas été testée dans le diabète. Méthodologie: Nous avons étudié la signalisation BMP9/ALK1 dans l’endothélium hyperglycémique et son effet sur la perméabilité rétinienne dans un modèle murin de diabète de type 1. La perméabilité rétinienne quantifiée par l’essai Miles et la surexpression de la BMP9 a été réalisée vecteurs adénoviraux. Résultats: L’activation d’ALK1 par la surexpression BMP9 chez les souris diabétiques a restauré la perméabilité physiologique en maintenant l’intégrité des jonctions interendothéliales, en partie en limitant l’action de la signalisation au VEGF. Nous avons également observé que la surexpression de BMP9 pouvait protéger l’endothélium rétinien chez les souris diabétiques en améliorant le contrôle glycémique sur une période de 4 semaines. Cet effet serait régulé principalement par l’inhibition de la gluconéogenèse hépatique. Conclusion : Nous avons démontré que la signalisation BMP9 agit au niveau vasculaire et métabolique pour protéger l’intégrité vasculaire de la rétine et pourrait donc être d’intérêt dans le développement de futures stratégies thérapeutiques ciblant l’OMD.
10
Le GDF-15 est associé à la capacité fonctionnelle et la dysfonction ventriculaire chez les patients avec une sténose aortique modérée à sévère et une fraction d’éjection préservée Lauren Basmadjian1, François Simard2, Nadia Bouabdallaoui2, Eileen O'Meara2, Normand Racine2, Michel White2, Anique Ducharme2, Martin Sirois2, Anita Asgar2, Reda Ibrahim2, Jean-François Dorval2, Raoul Bonan2, Raymond Cartier2, Jessica Forcillo2, Ismail ElHamamsy2, Christine Henri2 1
Université de Montréal, 2Institut de Cardiologie de Montréal
Introduction : Chez les patients atteints de sténose aortique (SA) sévère, le remplacement valvulaire (RVA) est indiqué lors de l’apparition de symptômes ou une baisse de la fraction d’éjection (FEVG). Le remodelage ventriculaire et la dysfonction diastolique surviennent souvent avant les symptômes et un RVA plus précoce pourrait être bénéfique. L’évaluation du risque chez ces patients demeure difficile et le GDF-15 pourrait aider.
Objectif : Évaluer l’association entre le GDF-15 et les facteurs de mauvais pronostique connus en SA.
Méthodes : Le GDF-15 a été mesuré chez 70 patients avec une SA modérée-sévère (AVA45%). Les patients ont été séparé en deux groupes, «GDF-15-bas» et «GDF-15-élevé», selon la valeur médiane de la cohorte. Les groupes ont été comparé; comorbidités cardiovasculaires, test de marche de six-minutes (6MWT), vitesse de marche sur 5m (5mGS), paramètres échocardiographiques de sévérité de SA et de dysfonction ventriculaire.
Résultats : L’âge moyen de la cohorte était de 68+/-13 ans avec une valeur médiane de GDF-15 de 1050 [688-1591pg/mL]. Les patients «GDF-15-élevé» étaient plus souvent masculin, âgé, et co-morbide. Une valeur élevée de GDF-15 était associée à une dysfonction ventriculaire; volume d’éjection et «strain» ventriculaire plus bas, et ratio E/e’ et volume auriculaire gauche plus élevés. Ces patients avaient une plus grande atteinte fonctionnelle (moins bonne performance au 6MWT et 5mGS).
Conclusion: Un GDF-15 élevé était associé à une atteinte fonctionnelle et une dysfonction ventriculaire. Le GDF-15 combine potentiellement ces prédicteurs de mauvais pronostic en un biomarqueur objectif. Plus d’études sont nécessaires. 11
INCIDENCE ET PRÉDICTEURS DE FRACTURES POSTTRANSPLANTATION HÉPATIQUE DANS UNE COHORTE DE PATIENTS TRAITÉS AVEC BISPHOSPHONATES Bégin MJ1, Ste-Marie LG1, Huard G2, Chartrand R3, Dorais M4, Rakel A1 1
Service d’Endocrinologie, Département de Médecine, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 2Service d’Hépatologie, Département de Médecine, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 3Service de Médecine Nucléaire, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, 4StatSciences Inc., Notre-Dame-de-l’île Perrot, QC, Canada Introduction: La perte osseuse est significative lors des 6 mois suivant une greffe hépatique et est associée à une augmentation du risque fracturaire. L’utilisation de bisphosphonates prévient cette diminution de la densité minérale osseuse (DMO) et réduit le risque fracturaire. L’objectif principal de cette étude était de déterminer l’incidence de fracture au cours des trois années suivant une première greffe hépatique chez des patients ayant reçu une prescription de bisphosphonates au congé de leur hospitalisation. L’objectif secondaire était d’étudier les prédicteurs de fracture chez ces patients.
Méthodes: Une étude de cohorte rétrospective a été menée auprès de patients greffés hépatiques entre 2012 et 2016 au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal. Les fractures vertébrales et non-vertébrales ont été incluses.
Résultats: 155 patients ont été inclus dans l’étude (âge médian 57 ans; 29.7% femmes). En pré-greffe, 14 patients (8.9%) avaient un T-score ≤ -2.5 à la DMO et 23 patients (14.8%) avaient une histoire de fracture de fragilité. L’incidence cumulative de fractures était de 17.5% à 36 mois avec un temps médian à la première fracture de 10 mois (3-22 mois). Les facteurs prédictifs de fractures en analyse multivariée étaient l’âge > 60 ans (HR 2.41; 95% CI, 1.06-5.49), le sexe féminin (HR 2.27; 95% CI, 1.00-5.14) et le new-onset diabetes after transplantation (NODAT) (HR 2.81; 95% CI, 1.23-6.45).
Conclusion: Les fractures sont une complication précoce et fréquente de la greffe hépatique chez les patients traités avec bisphosphonates, particulièrement chez les patients plus âgés, de sexe féminin et atteints d’un NODAT.
12
EXPRESSION ET RÔLE DU GÈNE OSTM1 DANS LA RÉTINE pardis yousefi behzadi1, Monica Pata2, Jean Vacher1,2 1
Université de Montréal, 2Institut de Recherches Cliniques de Montréal (IRCM)
Introduction: Nous avons caractérisé le gène Ostm1 responsable de la mutation ostéopétrotique spontanée grey-lethal (gl) chez la souris. La complémentation fonctionnelle des défauts hématopoiétiques a été obtenue dans les souris transgéniques PU.1-Ostm1-gl/gl mais ces souris meurent prématurément avec une neurodégénérescence sévére. Cette perte cellulaire affecte le système nerveux central dans son ensemble incluant la rétine. Méthodes Pour définir le rôle d’Ostm1 dans la rétine, nous avons caractérisé son expression dans cet organe et induit la perte de fonction d’Ostm1 dans l’épithélium pigmenté (RPE). Résultats: Des analyses PCR démontrent une expression d’Ostm1 dans l’œil total et enrichie dans la neurorétine et dans le RPE. Après avoir défini, avec des marqueurs protéiques spécifiques, les sous-populations cellulaires de la rétine, l’hybridation in situ détecte l’expression préférentielle d’Ostm1 dans la couche ganglionnaire, la couche nucléaire interne (INL) et le RPE. Basé sur ce profil d’expression, nous avons induit dans un premier temps la perte de function d’Ostm1 spécifiquement dans le RPE. Les souris Ostm1loxlox générées dans le laboratoire ont été croisées avec la lignée Bestrophine1-Cre (Best1-Cre). L’expression de la recombinase Cre est spécifique au RPE et n’est pas toxique. La perte d’expression d’Ostm1 dans le RPE se traduit par une perte graduelle des photorécepteurs avec l’âge indiquant un défaut fonctionnel du RPE. Conclusion: Ces résultats préliminaires suggèrent que l’expression post-natale d’Ostm1 dans le RPE est essentielle au maintien et au renouvellement des photorécepteurs de la rétine.
13
IMPACT DU CHANGEMENT DES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DIABÈTE GESTATIONNEL AU CENTRE DES NAISSANCES DU CHUM Bérubé-Thibeault L1, Arbour A1, El-Outari A1, Nadeau S1, Wo BL2,3, Godbout A1,3, Grand’Maison S1,3, Mahone M1,3 1
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Montréal, Québec, 2Département de gynécologie-obstétrique du CHUM, Montréal, Québec, 3Centre de recherche du CHUM, Montréal, Québec Introduction : Le dépistage pour le diabète gestationnel (DG) au CHUM était basé sur des critères plus stricts que ceux proposés par l’Organisation mondiale de la Santé en 2013. En mars 2015, les critères ont été harmonisés. Nous évaluons si le taux de complication de grossesse au CHUM augmente en utilisant des critères moins stricts.
Méthodes : Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective chez les femmes avec grossesse unique dépistées pour le DG entre mars 2015 et février 2016 avec le test d’hyperglycémie orale provoquée (HGOP) de 75g. 1303 femmes ont été inclues et trois groupes ont été analysés : Groupe 1, HGOP normal avec les anciens et nouveaux critères ; Groupe 2, HGOP normal avec les nouveaux critères seulement ; Groupe 3, DG avec les nouveaux critères. L’issue primaire est un composé de : poids de naissance ≥ 90e percentile, césarienne en travail, pré-éclampsie et hypertension gestationnelle.
Résultats : Le groupe 2 a un taux de complication plus élevé (47 patientes [37.2%]) que les femmes avec DG (53 patientes [23.6%]) ou le groupe contrôle (162 patientes [26.6%]). Le groupe 2 a un taux de complication 1.63 fois plus élevé (1.63; 95% intervalle de confiance, 1.08 à 2.46) que le groupe contrôle.
Conclusion : Nos résultats suggèrent un taux de complication plus élevé chez les femmes qui ne sont plus considérées DG en utilisant des critères moins stricts. Des prédicteurs anténataux sont requis afin d’identifier les femmes à risque et implanter des stratégies pour améliorer les issues.
14
INCIDENTALOME SURRÉNALIEN STABLE EN TAILLE ÉVOLUANT EN CARCINOME CORTICOSURRÉNALIEN 10 ANS PLUS TARD ASSOCIÉ À UN VARIANT DU GÈNE APC Pascale B1, Nadia G 1, Catherine A 1, Gilles C1, Mathieu L2, Irina B 6, Catherine B 1, Serge N2, Fred S 3, Katia C. 1, Zaki El H 4, Harold JO 5, Isabelle B1,4 1
Service d'Endocrinologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 2Département de Pathologie, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 3 Service d'Urologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 4Service de Génétique, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 5Service d'Oncologie, Département de médecine, Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Montréal, Québec, 6Division of Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, MN Introduction : Les lignes directrices récentes sur les incidentalomes surrénaliens stipulent qu’une masse de nature indéterminée qui n’est pas retirée chirurgicalement devrait être recontrôlée par imagerie 6-12 mois plus tard. Si la masse est stable et non fonctionnelle, le suivi pourrait être cessé. Cas : Nous rapportons le cas d’une Canadienne Française de 32 ans qui a été évaluée en 2006 pour un incidentalome surrénalien gauche de 27x20 mm. Le bilan hormonal initial était normal. Des imageries de contrôle ont été effectuées jusqu’en 2009, et la masse est demeurée stable, suggérant le diagnostic d’adénome. Perdue au suivi, la patiente est hospitalisée en 2016 pour des coliques néphrétiques. La masse surrénalienne gauche mesure alors 90x82 mm et deux lésions hépatiques sont identifiées. Le bilan hormonal démontre un hypercorticisme et un hyperandrogénisme. Le diagnostic de carcinome corticosurrénalien avec métastases hépatiques a été confirmé en pathologie. Méthodes : Des analyses immunohistochimiques ont été réalisées sur le tissu tumoral et un panel génétique oncologique a été fait sur l’ADN leucocytaire de la patiente après son consentement. Résultats :
15
Une accumulation d’IGF-2 et de β-caténine a été retrouvée dans le tissu tumoral. Un variant génétique germinale sur l’exon 16 du gène APC de signification inconnue a été identifié (c.2414G>A, p.Arg805Gln) (rs200593940). Conclusion : Un incidentalome surrénalien de petite taille qui demeure stable pendant 4 ans peut évoluer en carcinome corticosurrénalien après plusieurs années. Une meilleure caractérisation génétique de ces patients pourra conduire à une meilleure compréhension de cette évolution inhabituelle.
16
L’IMPACT DE LA SUPERVISION D’UN MÉDECIN LORS DE L’ACTIVATION DU LABORATOIRE DE CATHÉTERISME ET DU DIAGNOSTIC DE STEMI PRÉHOSPITALIERS Laurie-Anne B-P MD1,2, Alexis M MD SM1,2, Christine C P MD3, Alexandra B MD4, Samer M MD1,2, André K MD2, Éric Q MD5, François G MD2, Brian J P MDCM SM1,2 1
Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CRCHUM), Montréal, Québec, 2Centre Cardiovasculaire du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), Montréal, Québec, 3Hôpital Pierre-Boucher, Longueuil, Québec, 4 University of Alberta, Edmonton, Alberta, 5Hôpital Charles-Lemoyne, Greenfield Park, Québec Introduction : L’identification du STEMI sur le terrain et l’activation pré-hospitalière du centre d’hémodynamie (CH) est la méthode de référence pour diminuer le temps d’ischémie. Nous avons voulu déterminer si la supervision d’un médecin améliore la performance diagnostique des systèmes d’activation pré-hospitalière et l’impact sur les délais de traitement.
Méthodes : Entre 2012 et 2015, tout patient dans deux régions avec une plainte principale de douleur thoracique ou de dyspnée a eu un électrocardiogramme (ECG) sur le champ. Un diagnostic automatisé de STEMI a engendré soit une activation directe du CH ou une transmission de l’ECG à un urgentologue pour validation avant l’activation. La performance du système a été évaluée en termes de faux positif (FP) et d’activation inappropriée (AI) ainsi que de la proportion des patients avec un temps de contact au dispositif (first medical contact to device time ; C2D) ≤90 minutes.
Résultats : 488 activations ont été analysées (311 automatique ; 177 avec supervision). La supervision d’un médecin a diminué de 85% les IA (7% to 1%; p=0,012), mais a prolongé le temps de C2D médian avec une plus petite proportion atteignant le C2D cible (76% vs 60%; p 20 mmHg. L'impact de cette définiton sur la prévalence de l'HTP n'a pas encore été étudié. L'impact de l'HTP sur la survie post-TX à 30 jours et a très long terme demeure encore nébuleuse. Dans cette étude, nous avons invistigué les caractéristiques cliniques et hémodynamiques des patients avec HTP en pré-TX en utilisant les nouvelles définitions de l'ISHLT chez une cohorte de patient transplanté entre 1983-2014. Nous avons aussi évalué l'impact de la présence et de la sévérité de l'HTP sur la mortalité et les évenement cardiaque majeurs (MACE) en post-TX à 30 jours, 1 an et à long terme.
66
Rôle du traitement néo-adjuvant dans le cancer du pancréas non-résécable d’emblée : l’expérience au CHUM. Nassabein. R2, Richard. C3, routy bertrand1,2, Ayoub. J-P2, Aubin. F2, Campeau. M-P2, david donath2, delouya guila2, micheal dagenais2, Réal Lapointe2, richard létourneau2, Simon Turcotte1,2, marylene plasse2, Franck Vandenbroucke-Menu2, olivié damien2, roy andré2, mustapha tehfé2 1
CRCHUM/ Université de Montréal, 2CHUM, 3institut gustave roussy
Introduction: La résection chirurgicale suivie d’une chimiothérapie adjuvante est le traitement standard du cancer du pancréas de stade précoce. Pour les tumeurs « Borderline » (BR) et localement avancées (LA), la résection avec marges saines représente un important défi chirurgical. Le rôle ainsi que le type de traitement préopératoire restent à établir pour les cancers considérés non-résécables d’emblée. Méthodes : Nous avons revu rétrospectivement les cas des patients ayant reçu au CHUM des traitements néo-adjuvants (NAT) pour des tumeurs pancréatiques BR et LA. Les taux de survie étaient estimés selon la méthode Kaplan-Meier. L’analyse de sous-groupe, le risque relatif et l’intervalle de confiance étaient calculés par un modèle de Cox à risques proportionnels. Résultats: 90 patients (50 BR, 40 LR) avaient reçu un NAT au CHUM entre 2009 et 2017. La chimiothérapie était le seul NAT chez 51 patients (56,6%), la radio-chimiothérapie seule chez 23 patients (25.3%) et 16 patients (17,7%) avaient reçu un traitement séquentiel de chimiothérapie et radio-chimiothérapie. La résection tumorale a eu lieu chez 44 patients, dont 32 patients BR (R0: 68.7%) et 12 patients LA (R0: 75%). La survie sans maladie (SSM) des patients réséqués était de 12,3 mois. SSPm et SGm des patients réséqués étaient de 29 et 41,7 mois, comparées à 10 et 15,7 mois des patients non-réséqués, respectivement (p